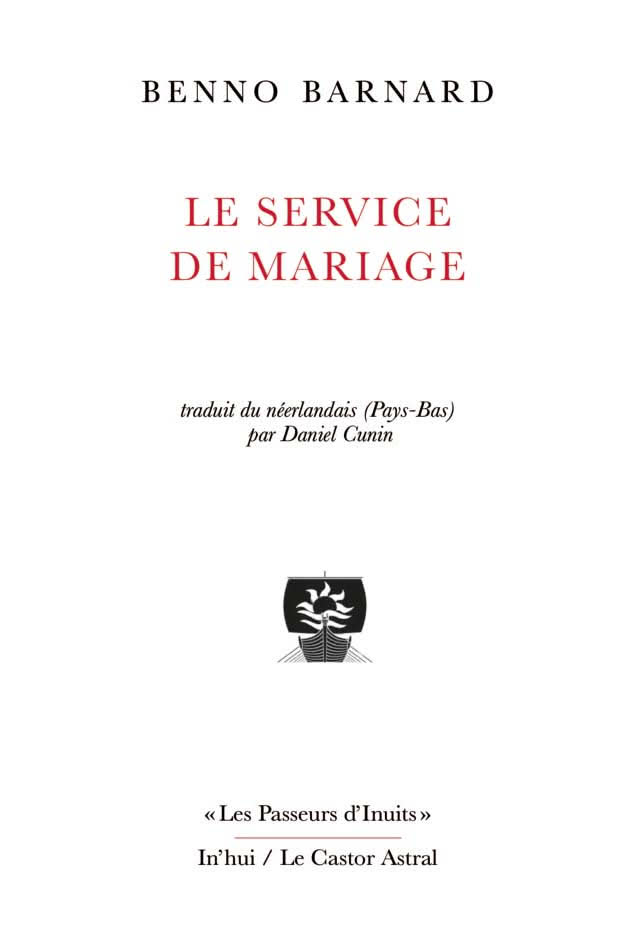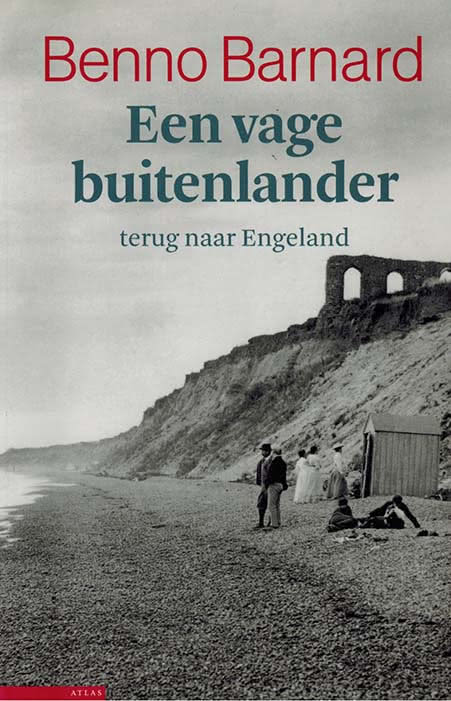Dieu a fait de moi un écrivain
tandis que le diable me faisait néerlandais1.
Le poète, essayiste, diariste et dramaturge néerlandais Benno Barnard fête en cette fin d’année 2024 son soixante-dixième anniversaire. Soit bientôt quarante-cinq années de publications. La singularité de son parcours – une existence hors des Pays-Bas depuis l’âge adulte et un amour jamais démenti pour l’Angleterre –, comparé à celui de la plupart de ses confrères et compatriotes qui évoluent sur la scène littéraire amstellodamoise, nous a incité à nous pencher sur le pourquoi et le comment de cette anglophilie.
•
«Paradis différé » (Barnard 1987), tel est le titre d’un volume de proses de Benno Barnard. Ce livre qui remonte à 1987 contient des essais et considérations qui portent essentiellement sur la Belgique. Autant d’accointances faites de tendresses et d’algarades avec ce premier pays d’adoption de l’écrivain néerlandais. À l’époque de la parution de cette œuvre, ce dernier vivait depuis plus d’une décennie de l’autre côté de la frontière batave, tantôt à Bruxelles, tantôt à Anvers. Puis le vent a tourné une page, une deuxième, bientôt une troisième : près de trente ans se sont ainsi écoulés. Et voilà que, depuis fin 2015, le natif d’Amsterdam peut dire qu’il a enfin au moins un pied au paradis. N’a-t-il pas, « en l’An 17 après Google », en effet concrétisé son aspiration sans doute la plus profonde en s’établissant pour de bon, avec sa petite famille, en pleine Angleterre rurale ? Ceci dans un cottage bâtit en 1665, au beau milieu d’un village verdoyant et vallonné du comté du Sussex de l’Est, dans le district de Rother, à 13 km au nord de Hastings – lieu où s’est déroulé la célèbre bataille qui a vu la victoire, en 1066, de Guillaume le Conquérant (1027-1087). Et à 6 km à l’ouest de Rye, un ancien port dessiné jadis par le peintre flamand Antoon Van Dyck (1599-1641), où l’on peut aujourd’hui visiter la Lamb House, demeure où le célèbre romancier Henry James (1843-1916) a passé la dernière partie de sa vie. Brede – tel est le nom de la petite localité en question de 1 800 habitants – est certainement un peu moins emblématique, historiquement, que ses voisines ; elle a toutefois accueilli l’écrivain américain Stephen Crane (1871-1900) ou encore la sculptrice Clare Sheridan (1885-1970), cousine germaine de Winston Churchill (1874-1965), dont on garde une belle et longiligne Vierge à l’enfant dans l’église locale. Une dizaine d’années avant ce déménagement, découvrant une autre bourgade des environs, l’auteur l’avait qualifié de « Village Absolu », celui qu’il aurait aimé ne devoir jamais quitter et où il aurait voulu être enterré (Barnard 2013 : 244). Ce village absolu, Brede l’est devenu ; aussi fait-il dorénavant office d’éden. Là, Barnard a l’impression de vivre dans un poème de William Wordsworth (1770-1850) avec, à l’horizon, l’univers de Narnia.
Un pied au paradis
L’écrivain a renoué avec une existence enchantée loin de la ville, tout comme à l’époque de son enfance et de son adolescence passées dans la province de Gueldre – une bonne décennie après le jeune namurois Jean-Claude Pirotte (1939-2014) (Pirotte 2005). Ceci loin de la campagne flamande plutôt hostile et grisâtre où il a vécu durant quelques années avant d’enjamber la Manche pour de bon. Le paradis acquis, c’est entre autres les vieilles pierres, une demeure spacieuse :
Tout les gens de mon entourage aspirent à un logement plus petit, jusqu’à ce qu’il ne leur reste plus qu’un cercueil, alors que moi, je désire une habitation plus grande, ne serait-ce que pour y caser la bibliothèque de littérature anglaise de mon père. (Barnard 2013 : 205)
Un bâtiment plus modeste qui s’élève à côté du cottage, dans le jardin attenant, abrite ces deux mille ouvrages en attendant d’être, un jour prochain, aménagé en logement-atelier pour un ami ou un artiste de passage.
Dès la prime enfance, celui qui est reconnu comme l’un des stylistes d’expression néerlandaise parmi les plus brillants de sa génération a cultivé des liens étroits avec le Royaume-Uni en général, et plus particulièrement avec l’Angleterre – on l’aura compris, son second pays d’adoption. Il y a en effet effectué de nombreux voyages, y posant même son landau – au premier étage du 24, Clifton Street à Barry (Pays-de-Galles, avril-octobre 1956 : Oh, to be in England / Now that April’s there…) et au Somerset House Hotel, 6 Dorset Square, Londres (fin novembre-début décembre 1956) –, par la suite sa valise à bien des reprises, en particulier dans le Somerset à l’âge de douze ans, à la Cambridge Road de Plymouth à l’époque estudiantine (1973 puis automne 1975-été 1976) et à Rye (début septembre 2005-fin août 2006). Dans son Dagboek van een landjonker (Journal d’un hobereau), le diariste s’adresse d’ailleurs un jour à son bagage pour lui faire partager sa joie de rejoindre le Royaume-Uni : « Je raconte à ma valise pourquoi je suis en train de la boucler : ‘‘Demain, nous partons en Angleterre, toi et moi… et Joy…”2 » (ibid. : 321)
Benno Barnard à Paris en 2019
Photo : © D. Cunin.
De même que le romancier Eddy du Perron (1899-1940) se disait Français atavique, de même le jeune Benno s’est défini, ceci dès l’âge ingrat, comme un Anglais atavique (Barnard 2009 : 8). Le Hollandais porte incontestablement moins la France dans son cœur que le Royaume-Uni. Son affection à l’égard du premier de ces pays se teinte en général d’une ironie assez britannique : « Les Français… pourquoi les fréquenter si ce n’est pour pratiquer la langue française ? » (Barnard 2013 : 79) Les Le Clézio (°1940) et autres Annie Ernaux (°1940) n’ont pas l’heur de lui plaire ; en ce qui concerne les Encyclopédistes – « cette clique gauloise » –, il a tendance à se ranger à l’avis d’un Edmund Burke (1729-1797) et du Wystan Auden (1907-1973) auteur du poème « Voltaire at Ferney » (ibid. : 60-61). Ayant avalé des centaines de pages du Journal de Julien Green (1900-1998), Barnard se demande, à propos du bilinguisme de l’Américain, comment il est bon sang possible d’écrire en français ce qu’on est à même d’écrire en anglais, une langue à ses yeux « bien plus souple, plus objective aussi et bien plus riche » que celle que défend l’Académie française (Barnard 2019 : 130). Mais c’est bien plus l’humour que le préjugé qui transparaît dans pareilles assertions. Rappelons tout de même à Benno que Brede doit, semble-t-il, son existence au pays qui s’étend de l’autre côté du Channel – en tous les cas à la Normandie –, puisque l’église Saint-Georges – dédiée au patron de l’Angleterre –, qui s’élève en face de son cottage, a été fondée par l’abbaye de Fécamp. Une église depuis le clocher de laquelle on distingue, par ciel dégagé, au-delà des vagues, l’ennemi héréditaire. Quant au lien qu’il entretient avec ses terres natales quittées depuis bien longtemps, il avoue que le football est « le seul aspect de sa vie d’homme dans lequel il se sent pleinement néerlandais » (Barnard 2013 : 28). On pourrait y ajouter une fidélité de toujours à sa langue maternelle, une langue qui, après tout, n’a rien à envier à l’anglais.
Le titre d’un des livres sans doute les plus représentatifs du Hollandais, Een vage buitenlander, renvoie à un passage d’Heures anglaises du vieux voisin Henry James : « il faut des pèlerins passionnés, de vagues étrangers, et autres personnes déshéritées, pour apprécier le “caractère” de cet admirable pays » qu’est l’Angleterre. Ce récit relate une année (1er septembre 2005-fin août 2006) passée à Rye par la petite famille Barnard : Anna, la fille adoptive issue d’un orphelinat de Mère Theresa (1910-1997), Christopher, le fils excellent footballeur, la blonde épouse américaine Deanne et le père et mari Benjamin, surnommé depuis l’enfance, à son corps défendant, Benno. Ce dernier a obtenu d’un hebdomadaire flamand de séjourner dans cette charmante ville afin d’y tenir une chronique britannique. Pour un auteur qui s’est fait une spécialité d’écrire une autobiographie généalogique à partir des mythes qu’il élabore lui-même depuis l’enfance – souvent dans le sillage de Willem, le père –, les 250 pages de ce volume – 13 chapitres, soit 7 portant des titres différents, entre lesquels s’en intercale systématiquement un qui porte le titre du livre et la mention « Terug naar Engeland » (De retour en Angleterre) – illustrent à merveille sa technique narrative. Et son credo : « Tout art est artificiel ; l’art est ce qui pourrait être3 » (ibid. : 36, 193). À travers l’Angleterre, il ancre son passage ici-bas dans un passé qui remonte à la nuit des temps tout en reliant, au fil de l’écriture, diverses histoires de différentes époques, certaines encore non avenues, qui, toutes, en viennent à former la relation de sa propre vie. Ainsi passe-t-il sans difficulté du moment présent à un épisode du passé ou d’un futur fantasmé comme si ce dernier s’inscrivait toujours dans le présent. En 2005, par exemple, alors que les Barnard gagnent le Royaume-Uni en traversant la Manche à bord d’un ferry, il écrit qu’il n’y a pas à s’inquiéter « puisqu’on est toujours en un été des années soixante » : en d’autres mots, il se sent en réalité tout à la fois à bord du bateau et… d’un train en compagnie et sous la protection de sa mère et de son père (Barnard 2009 : 7). Et lui reviennent aussi en mémoire les traversées les plus enivrantes, celles où la famille embarquait à Hoek van Holland pour arriver à Harwich. Impression que tous les évènements de l’existence se déroulent en même temps comme dans An Experiment with Time (Le Temps et le rêve, 1927), livre de J. W. Dunne (1875-1949). L’année à Rye – où leur plus proche voisin n’était personne d’autre que Paul McCartney (°1942) – est en même temps celle du coup de cœur pour les paysages qui bordent la Brede, cours d’eau qui a donné son nom au village où les Barnard devaient s’installer une décennie plus tard. Depuis longtemps, Benno a la nostalgie des paysages inaltérés, ceux non encore défigurés par la révolution industrielle, ceux qui ont vu grandir un William Blake (1757-1827) et un John Constable (1776-1837). « À mes yeux, le paysage anglais est un grand Wind in the Willows4 » (Barnard 2013 : 207).
Saisir les tenants et les aboutissants de l’attachement quasi-viscéral de l’essayiste et poète aux terres insulaires, suppose de marcher dans les pas du père, Willem Barnard (1920-2010), pasteur et théologien, plus connu peut-être sous son nom de poète : Guillaume van der Graft5.
Une transmission réussie
Les futurs parents de Benno sont subjugués par l’Angleterre lorsqu’ils y séjournent les premières fois (1948 et 1949). Willem y retourne dès qu’il en a la possibilité. Un jour, lors d’un passage dans le Devonshire, il décide de se laisser pousser la moustache : elle lui conférera pour le reste de ses jours une apparence de colonel britannique « ayant un faible pour le cherry et la chasse au renard » (Barnard 2013 : 113). En 1956, grâce à une bourse d’études, le jeune papa qu’il est encore passe environ six mois au Royaume-Uni (Barry) avec son épouse, l’ancienne institutrice Christina van Malde (1919-1995) – surnommée Tinka –, leur fille Renata et le bambin. En novembre de la même année, peu avant que le petit Benno ne fête son deuxième anniversaire, l’URSS écrase la révolution hongroise. Ayant vu sa ville Rotterdam anéantie par les bombes nazies en mai 1940, le couple redoute plus que tout une nouvelle guerre. Sans compter que Willem reste traumatisé par la peur et les souffrances qu’il a endurées à Berlin après avoir été réquisitionné par les usines Siemens dans le cadre du STO. Seule issue : s’éloigner de la menace. Alors que les Barnard sont à peine rentrés en Hollande, ils retraversent la mer, dans le sens inverse, cette fois pour se réfugier à Londres. Autrement dit, Benno a plus ou moins appris à marcher sur le sol insulaire et a prononcé, parmi ses premiers mots, des sons shakespeariens. Bien plus tard, dans l’un des volumes de son Journal, il imagine qu’il garde de ces premières expériences une certaine nostalgie : celle des plages de galets locales, du 52 de la Clifton Street, des chorales, de la poésie… (Barnard 2019 : 27-28) C’est aussi de l’époque de l’agression khrouchtchévienne que date son plus vieux souvenir, celui d’une imposante locomotive noire dont la vapeur empli une gare, image dont il tirera en partie le poème « De stoomtrein », lequel concrétise l’établissement définitif outre-Manche :
La locomotive à vapeur6
À la gare, encore plongée dans ses pensées –
qui va se risquer à blâmer son apathie ?
Astiquée à la brosse à cirage, sa masse
décuple peu à peu sa vitesse : un frisson
traverse l’aujourd’hui ; elle halète. Oui, fadaise
anthropomorphe, mais ai-je pris une seule ride ?
Ô ! peste de toi, présent ! Elle pellette à son aise
de la vapeur blanche par-dessus son épaule.
Les chiens, incapables d’attraper ce mouton,
baissent la tête. Une rare perfection
bucolique s’étend sur la vallée anglaise.
La pente lente qui conduit à Tenterden
la contrarie ; elle n’en est pas moins à l’heure.
Il n’a pas de prix, papa, maman, mon aller simple.
Ce train réapparaît dans l’œuvre ou en appelle d’autres à la rescousse, tout aussi anciens, par exemple le Poudlard Express ou encore le « Night Mail » de W. H. Auden. Mais à un autre endroit de l’œuvre barnardienne, on est en présence d’un second souvenir « premier », une scène située à Barry :
Mon plus ancien souvenir est une chemise qu’agite le vent, sans doute appartenait-elle au père d’un enfant du quartier. L’image est accompagnée d’une voix de femme qui me dit « Now eat your tea, Ben ! » : probablement Mrs Hood, cette Anglaise qui nous apprend, à ma sœur et à moi, comment, dans son pays, chacun mange son thé, car le thé est bien plus qu’un liquide pour les Britanniques qui souffrent d’une affection gastrique. […] Riche en associations d’idées mythiques, dégoulinante de kitsch, ma petite enfance n’a pas moins été marquée par un décent manque d’argent. Je prends la chemise sur la corde à linge et l’enfile avec précaution. Elle me va bien. (Barnard 2013 : 243-244)
Barnard n’hésite pas, au fil du temps, à modifier et nuancer les teintes de ces remémorations, poussant plus loin la légende, un peu à la manière de l’écrivain André de Richaud (1907-1968) ou de son quasi-homonyme, et voisin provençal, le peintre Maxime Richaud (1924-1994). Par moments, le Néerlandais revisite son passé dans la peau, si l’on peut dire, de l’un des fantômes qui se manifestent dans certaines vieilles habitations du Sussex, lesquelles ont, qui sait, en une lointaine époque, abrité des lieux de débauche. Ou de ceux qui hantent le pub vieux de cinq siècles que l’auteur a fréquenté au cours de l’année heureuse vécue à Rye, au début de ce xxie siècle. Il paraît que des hôteliers britanniques vont jusqu’à souscrire une assurance au cas où l’un de leurs clients serait agressé par un revenant. En conséquence, le clergé anglican de son altesse royale compte dans ses rangs, à l’instar de son homologue catholique sur le continent et ailleurs, des… exorcistes.
Si Tinka et Willem retournent chaque été en Angleterre avec leur progéniture – une petite Marieke est venue compléter la fratrie –, ce dernier ne se définit pas comme anglophile : il préfère, tant ce pays l’électrise, le terme « anglosexuel ». Même si pour un étranger, avance-t-il, faire bon ménage avec l’anglitude ne va pas forcément de soi : « Ça reste un peuple marquant, avec sa précision toute latine, sa puissance d’imagination celtique, sans oublier sa dose de bon sens paysan d’origine saxonne7. » Willem/Guillaume devance son unique fils en élaborant une généalogie fictive à laquelle la lignée masculine va se plaire à croire : la famille viendrait d’un châtelain Barnard, patronyme dérivé de berenhart (cœur d’ours). Tout est parti d’une gravure rapportée, en 1969, du comté de Durham représentant le Barnard Castle8, ruine d’un château médiéval ayant appartenu à un Lord Barnard. On ne va certes pas jusqu’à se comparer au stadhouder Guillaume III (1672-1702), devenu roi d’Angleterre, d’Irlande et d’Écosse. Quoique, du côté maternel, ne s’imagine-t-on pas descendre de Richard Cœur de Lion lui-même (1157-1199), certes pas en ligne tout à fait directe ? (Barnard 2023a) Malgré le sang bleu supposé, on se défend de redéterrer Oliver Cromwell (1599-1658), quand bien même on n’éprouve guère de sympathie pour ce régicide. Et on ne s’identifie aucunement aux frères de Witt – ni à Johan (1625-1672), ni à l’aîné Cornelis (1623-1672) – entreprenant le raid sur la Medway pour remporter la plus grande bataille navale batave sur la flotte anglaise. Bien au contraire. On suppose plutôt une action militaire en sens inverse : un Barnard qui aurait quitté l’île pour venir en aide au prince d’Orange… Et deux ou trois autres morts quelques siècles plus tard dans les tranchées du côté d’Ypres… Qu’elles soient réelles ou fictives, ces scènes historiques apparentées à l’Angleterre, tirent une larme au père et au fils, à Willem et à Benno (Barnard 2013 : 251).
Couverture de la version française de Le service de mariage (Le Castor Astral, 2019)
Photo : © D. Cunin.
La fibre collectionneuse
Du premier, le second a en réalité hérité tout un patrimoine intellectuel, spirituel, culturel et même « paysagiste », pourrait-on dire. En d’autres mots : la fascination qu’exercent les romans anglais, dont ceux destinés aux jeunes lecteurs ; un amour inconditionnel de la poésie de la trinité anglicane T. S. Eliot (1888-1965) – que Guillaume a rencontré à Londres –, W. H. Auden et W. B. Yeats (1865-1939), mais aussi de celles des poètes métaphysiques, à commencer par John Donne (1571-1631) ; et une réelle passion pour bien d’autres auteurs, artistes, rites, traditions, lieux symboliques, édifices et contrées rurales de différents comtés… Premier livre anglais qui a marqué le fiston Barnard : The Jack and Jill Book 1957, album illustré qu’il a reçu, nous dit-il, en guise de cadeau pour son deuxième anniversaire au Somerset House Hotel de Londres ! Sa mère lui en a fait la lecture en anglais en traduisant tout, phrase à phrase, en néerlandais. Quant à The Children of Green Knowe, il en possède un exemplaire que lui a offert son père qui venait de le relire, trois semaines avant de mourir (ibid. : 260). S’il aime s’entourer de gravures anglaises et de divers bibelots, l’exilé choie et étoffe surtout peu à peu la collection de ces livres jeunesse que lui a laissée Willem. Une grande partie de cette littérature est une littérature d’évasion, explique-t-il :
voyage dans le temps, magie et sorcellerie, fuite dans un Moyen Âge imaginaire. Je comprends tout à coup pourquoi je collectionne à la fois de tels volumes ainsi que de la poésie moderniste. Fondamentalement, dans Le Neveu du magicien, C. S. Lewis fait la même chose que T. S. Eliot dans The Waste Land. (ibid. : 159)
Dans une édition bibliophilique, rehaussée de photographies prises par son fils Christopher, le Néerlandais présente et commente certains de ces volumes, certaines de ces jaquettes colorées. Le sous-titre de la plaquette Een inleiding tot de anglopedofilie (Une introduction à l’anglopédophilie) parle de lui-même (Barnard 2019)9. Non seulement, il enrichit peu à peu cet ensemble – une première édition de Caxton’s Challenge de Cynthia Harnett (1893-1981), une autre dédicacée par Philip Pullman (°1946)… –, mais il relit avec plaisir certains des romans en question, par exemple The Warden’s Niece (1957) de Gillian Avery (1926-2016), l’un de ses neuf titres préférés (Barnard 2009 : 150). Sa fibre de collectionneur – collectionner, « une manière de jouer un mauvais tour à la mort » (Barnard 2013 : 156-157) – se met tout autant à vibrer quand il prend en main la carte de visite du « plus grand moderniste de la langue anglaise » (Barnard 2015 : 15), T. S. Eliot, au dos de laquelle ce dernier a griffonné quelques mots pour papa Willem. Même chose quand il retrouve par hasard une lettre de la veuve de Nabokov (Barnard 2013 : 218). Autant de reliques de l’univers anglo-saxon qui peuplent désormais le cottage de Brede à côté d’un ou deux inséparables border collies. Un jour de 2012, Benno n’a pas hésité à se rendre, depuis son domicile flamand, dans le Yorkshire uniquement pour y apporter trois des livres que lui a légués Willem et qu’il estimait nécessaire de restaurer (ibid. : 277).
Ce n’est pas un hasard si, par l’intermédiaire de The Ship that Flew (1939), livre de Hilda Lewis (1896-1974), la littérature jeunesse (en l’occurrence un Oxford Children’s Modern Classic) est présente dès la première ligne d’Afscheid van de handkus (L’adieu au baisemain, 2023), l’unique roman écrit à ce jour par Barnard. Si l’histoire porte essentiellement sur l’une de ses thématiques récurrentes, enveloppée de nostalgie – à savoir la disparition de la société multiculturelle de l’Empire austro-hongrois au début du xxe siècle10, ébranlement indissociablement lié au sort des populations juives des contrées en question –, l’Angleterre est également présente en toile de fond à travers Oxford. On tient en effet en main une histoire censée être écrite par un historien-bouquiniste de cette ville universitaire, spécialiste justement de la fin de la Double monarchie et descendant d’une famille ayant dû fuir les pogroms de Hongrie. Une fois exilé, Jacob, le père du narrateur, se veut – tiens, tiens… – plus Anglais que les Anglais eux-mêmes. Avant de refermer le chapitre de l’anglopédophilie, relevons que Benno contrebalance cet amour « contre nature » pour les livres pour enfants par une forme, chaste dirons-nous, de gérontophilie. Car ne s’emploie-t-il pas, parallèlement, à collectionner des Vieilles Dames Anglaises ? Voisines avec lesquelles il aime papoter, femmes raffinées qui lui offrent de boire le thé chez elles, sans oublier les veuves propriétaires de séculaires demeures qui ouvrent leurs portes à ce curieux devant l’éternel…
Willem a par ailleurs légué à son fils toute une série de guides sur les comtés anglais ; il arrive à celui-ci de voyager et de s’égarer, un de ces volumes datés des années trente ou quarante du siècle passé dans son bagage. Une manière de revivre les pérégrinations communes faites à bord d’un bus à impériale. Bien des fois, Benno retourne en effet visiter des localités et des édifices où son père l’avait guidé. En sa compagnie, il a développé, on l’aura compris, une passion inconditionnelle pour le passé du Royaume-Uni. En particulier pour les trésors préservés de l’architecture et les grands jardins aux fleurs et aux essences les plus surprenantes. Chez les Barnard, chacun est membre, de père en fils, ceci, dirait-on, depuis la nuit des temps, du National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty. On saisit la moindre occasion, le moindre prétexte pour évoquer l’immense cathédrale à trois clochers de Lichfield, le Triangular Lodge, l’ancienne résidence des Churchill ou bien celle que la reine Victoria a fait bâtir, en 1847, sur l’île de Wight. À cette immense Osborne House, Benno, qui possède des rayonnages de livres sur l’époque victorienne, consacre un chapitre de son Vague étranger en une prose qui offre un très bel équilibre entre descriptions et contexte historique, anecdotes et détails prosaïques, humour et introspection, allusions à des poètes ou à des bibelots, allers et retours entre passé plus ou moins lointain, jour d’aujourd’hui et avenir hypothétique… Les demeures de bien des écrivains et d’autres personnalités l’ont vu passer. Contentons-nous de citer Elizabeth Goudge (1900-1984), Lucy M. Boston (1892-1990), mais aussi Christopher Robin Milne (1920-1996) – le garçon qui a inspiré à son père le personnage de Jean-Christophe et celui de Winnie l’Ourson –, le peintre John Constable ou encore la figure historique controversée John Cromwell. Aux yeux du diariste, le musée consacré au lexicographe Samuel Johnson (1709-1784) est habité « d’une sorte de distinction ironique à laquelle les Français ne sauraient parvenir » (Barnard 2009 : 66). Les nombreuses propriétés considérées comme des trésors nationaux depuis qu’elles ont abrité des gens de lettres, amènent le Hollandais à s’exclamer : « Quel prodige, cette vénération des Britanniques pour leur patrimoine littéraire ! Toutes ces maisons d’écrivains, tous ces lieux de pèlerinage, disséminés dans les îles britanniques, qui ensemble forment une sorte de Conscience Littéraire Nationale. Pourquoi n’empaillent-ils pas leurs défunts poètes ? » (Barnard 2015 : 165) Autre legs fascinant, celui des cimetières ruraux, là où l’on a envie d’être enterré ne serait-ce qu’une poignée de jours et où l’écrivain n’hésitait pas, entre les moussues tombes séculaires, à taper dans un ballon de foot avec son jeune fils. À force de contempler pareils endroits, il a l’impression que le temps passe moins vite dans l’archipel qu’ailleurs et que la population semble détenir « une conscience historique collective qu’on ne trouve, pour le reste, nulle part au monde11 » (Barnard 2013 : 246).
De Willem, Benno tient aussi le goût du pub. Selon lui, par son allure, sa tenue vestimentaire, le timbre de sa voix, ses réflexions, le père s’inscrivait mieux que personne dans un tel décor. Pour le fils, une évocation de cette institution où l’on se restaure et boit de la bière auprès de l’âtre se transforme bien vite en une suite de disgressions qui embrassent ses sujets de prédilection. La public house n’est-elle pas le lieu où s’exprime, par excellence, l’ironie britannique, où l’on apprend le sens de la formule juste, où l’on aime à avouer son attachement à la tradition, à la monarchie… ? Un pub reconstruit en 1667 présentant sur sa façade la liste des souverains qui se sont succédé depuis cette date, fait dire à l’écrivain que ce genre d’établissements produit sur l’organe historique des Anglais le même effet que la pornographie sur le sexe masculin (Barnard 2009 : 59).
Ce n’est pas sans vague à l’âme que Barnard revient sur les pas de son père et sur les siens propres. « À table, Souvenir tient de graves monologues, mais il arrive que ce soit avec Nostalgie, sa sœur certes moins cultivée que lui, que je me glisse dans mon lit ; maquillée de façon un tantinet hystérique, elle ne demeure pas moins irrésistible. Elle m’invite à Londres, un rendez-vous au Somerset House Hotel. Là se joue mon propre film sur la Restauration de ma prime enfance. » (ibid. : 58) Cet hôtel londonien où l’on avait fêté son deuxième anniversaire, il y est en effet retourné en 2006 : « Je viens, selon toute vraisemblance, fêter des noces d’or avec moi-même : je suis marié depuis cinquante ans avec l’Anglais en moi. » (ibid. : 60) Cependant, la désillusion l’attend parfois quand tout a changé entre-temps. Ainsi, de ce lieu de la capitale. Ou encore de l’église Saint-Marc de Plymouth : en 2007 alors que Benno désire revoir le révérend qui, trente ans plus tôt, l’avait accueilli dans son presbytère attenant à cet édifice, il ne trouve, en lieu et place de ses souvenirs, qu’un terrain vague.
Entre poésie et anglicanisme : une œuvre à faire
Pour certains enfants d’artistes ou de célébrités, l’héritage est difficile à porter. Les psys arrivent à la rescousse. Malgré les doutes, les drames et la mélancolie, rien de cela chez Benno Barnard. La psychologie lui paraît tout à fait néfaste. Quant à ce qu’il doit à ses parents, il se montre reconnaissant :
Trois semaines avant la mort de mon père, j’ai écrit une dernière lettre au moribond : « Entre-temps, je sais qu’en sillonnant ton et mon Angleterre, je ne cesserai d’entretenir Christopher et Anna d’un Autrefois, car chaque voyage renferme tous les voyages précédents, à la manière de l’oignon ses couches, un tel voyage relevant de notre histoire commune, laquelle a commencé bien avant notre naissance… Si je t’écris cela, c’est aussi pour t’assurer une fois de plus que j’ai eu une jeunesse remarquable. Plus qu’une jeunesse heureuse. Ces années m’ont également transmis une mission. Toute la mythologie de notre maison romantique, les hobbits et les trolls qui habitaient derrière le château, dans le réseau racinaire des vieux feuillus, les longs étés en Angleterre, ces chers livres pour enfants, la religion sous la forme d’une histoire, la notion d’écuyer empruntée à The Once and Future King et à L’Écuyer du Roi de Tonke Dragt… Ah ! je pourrais continuer longtemps comme ça. Toi et maman avez été des parents formidables et vous ne le saviez même pas. » (Barnard 2013 : 231)
Le Hollandais ne nie en rien sa dette à l’égard du père écrivain dont les goûts et le tempérament l’ont grandement marqué. « Un père écrivain, c’est un père multiple » (Barnard 2009 : 171), écrit-il. Ces différentes facettes lui ont en réalité laissé le champ libre pour évoluer à sa propre manière dans le champ littéraire, et à la différence de Willem en grande partie à l’écart de la Hollande, même s’il publie lui aussi la plupart de ses œuvres dans son pays d’origine. Il ne s’agit pas tant d’imiter que de chaparder, de marauder dans l’œuvre des prédécesseurs, à commencer par celle des auteurs de prédilection, ceux qui finissent par habiter votre cerveau. Même s’il tient de son père l’habitude de tenir un Journal littéraire – lequel est loin d’être un déversoir d’anecdotes intimes –, même s’il a suivi son exemple en écrivant des poèmes ancrés dans l’univers britannique12, les deux œuvres sont loin de se confondre l’une avec l’autre. Een vage buitenlander est un ouvrage bien différent de celui qu’a laissé Willem trente ans plus tôt sur certains de ses séjours en solitaire au Royaume-Uni – en quelque sorte un journal poétique sur leurs terres d’origine mythique (W. Barnard 1975). Si un tel livre peut être source d’inspiration pour le fils, il est surtout un autre moyen de voyager, non en bus à impériale, mais sur des phrases et des mots : « Savais-tu que town est, à l’origine, le même mot que notre tuin néerlandais, notre jardin ? » Willem a aussi passé le virus « Angleterre » et « anglican » à l’un de ses amis, le poète Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) (Rijken et al. 2015). Il est arrivé aux deux hommes de traverser la Manche ensemble. En publiant Een tuin in het water. Reizen in Engeland (Schulte Nordholt 1960), le second a d’ailleurs précédé le premier dans l’écriture d’un livre sur le sujet.
La couverture de Een vage buitenlander (éd. Atlas Contact, 2009)
Photo : © D. Cunin.
À Utrecht, Willem Barnard a fait le choix, à un moment donné – après avoir renoncé à sa charge de pasteur –, de l’Église vieille-catholique. De son côté, Benno est devenu anglican au plein sens du terme. Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain. En pleine adolescence, après une éducation reçue au sein de l’Église Réformée des Pays Bas, il a abandonné la foi, ne fréquentant alors plus, en Hollande, que les Églises wallonne, anglicane et allemande, ceci en vue de faire plaisir à sa mère : y avait-il pour lui meilleure manière d’améliorer sa connaissance du français, de l’anglais et de l’allemand ? (Barnard 2013 : 34) Après une longue période d’athéisme, le retour à une pratique religieuse à la fin du xxe siècle coïncide avec l’expérience de la paternité et la volonté, partagée avec son épouse, de faire baptiser leur fils Christopher. L’anglicanisme est sans aucun doute une manière de se sentir plus anglais encore dans un pays où maints intellectuels et une partie de l’élite optent pourtant pour le catholicisme. Dès son premier séjour en Angleterre, Willem avait été fasciné par les rituels de la High Church ou encore par la chorale de Canterbury. Benno lui a emboîté le pas tout en adhérant à l’opinion de G. K. Chesterton (1874-1936) selon lequel « la religion est une chose terrible, une force qu’on ne saurait malheureusement éradiquer dans l’homme », mais « que le christianisme, en fin de compte, a réussi à mieux contenir que les autres croyances » (ibid. : 160).
Le choix de l’anglicanisme ne se conçoit pas sans la fréquentation des poètes. À Eliot, Auden et Yeats, Barnard consacre de belles pages, en particulier dans Mijn gedichtenschrift (Barnard 2015), suite d’essais qui s’arrêtent sur l’œuvre et la vie de quelques dizaines d’auteurs de diverses contrées, allant de la mystique brabançonne Hadewijch d’Anvers (xiiie siècle) au Hongrois János Lackfi (°1971) en passant par Jacques Brel (1929-1978). Chaque texte s’ouvre sur un poème retenu par le Néerlandais, parfois traduit par ses soins. Bien entendu, il se reconnaît sur bien des points dans Eliot – alors que Benno avait quinze ans, son père lui a lu The Journey of the Magi, d’une voix qui l’a tout autant formé que les vers de Guillaume van der Graft –, étranger qui, cherchant à se faire à tout prix britannique, s’est converti à l’anglicanisme. Si le Hollandais ne partage pas la frilosité de l’Américain à l’égard de la gent féminine, il souligne lui-même plus d’un parallèle avec son prédécesseur : « L’Église a donc nourri son obsession du temps, mais elle lui a aussi offert une tradition poétique, des textes ridés, cet anglais supérieur de la King James Version et du Book of Common Prayer, qui résonnent dans son œuvre, au même titre que les hymnes de Herbert, d’Isaac Watts, de William Cowper, de William Blake, et tous ces timbres, toutes ces sonorités des formules – cette si remarquable littérature sous forme liquide – qu’on appelle liturgie, mythe vivant. » (Barnard 2002) Pour ce qui est d’Auden, Barnard considère son « In Memory of W. B. Yeats » comme l’un des plus grands poèmes du siècle passé. Quant aux derniers vers de « Church Going » de Philip Larkin (1922-1985) – confrère que Guillaume van der Graft a connu –, ils expriment à ses yeux le charme que peut exercer sur les esprits toute ancienne église de l’Angleterre rurale. De l’avis de Benno, l’anglicanisme – indissociable du poème « Jerusalem » de William Blake – présente un avantage tant sur les différentes autres branches du protestantisme que sur le catholicisme : il s’agit d’une pratique religieuse qui n’a guère traumatisé ses fidèles car elle est étrangère à toute forme de fanatisme. L’attrait qu’exerce la poésie des grands auteurs acquis à cette foi se trouve renforcé par la beauté des chants et de la musique qui retentissent souvent lors des offices. D’autres œuvres musicales affermissent les convictions du Hollandais, ainsi de King Arthur, or The British Worthy, le semi-opéra de Henry Purcell (1659-1695) composé sur un livret de John Dryden (1631-1700) : « Le bonheur qu’il y a à entendre une Vénus un tant soit peu douée chanter l’aria Fairest Isle fait de quiconque n’est pas sourd comme un pot un anglophile impénitent. » (Barnard 2014)
Même si l’écrivain ne se considère en rien comme un croyant fanatique – loin de là ! –, ses choix font que beaucoup le considèrent comme un « conservateur ». Il avance qu’il préfère, aux attentes utopiques, un ancrage dans un véritable héritage religieux et culturel ainsi que dans le souvenir, lesquels se révèlent bien moins dangereux que ces dernières. Lecteur de George Orwell (1903-1950), de Chesterton, de Burke et de Roger Scruton (1944-2020), il se définit en réalité comme un « conservateur de gauche – une créature qui relève de la catégorie des animaux fabuleux, des griffons, des paradoxes bipèdes » (Barnard 2009 : 154). Ses lectures ne s’arrêtent d’ailleurs aucunement à ces auteurs. Outre les poètes qu’il choie, il faudrait énumérer tous les historiens, philosophes, scientifiques, économistes, théologiens, voyageurs, biographes, diaristes et romanciers qu’il fréquente, en vers et en phrases ou en chair et en os, pour parfaire son anglitude, lui dont la couleur préférée, confie-t-il non sans humour dans une interview fictive qu’il donne à Marcel Proust (1871-1922), est le rouge des boîtes aux lettres britanniques (Barnard 2013 : 84), le même que celui du bus à impériale qui s’arrête deux ou trois fois par jour à Brede, entre son cottage et l’église Saint-Georges. « Restons rationnel, assure-t-il, sur ce ton mi-grave, mi-léger qu’il affectionne, pour justifier ses positions. Les Lumières françaises m’ont appris la nécessité de la dérision ; la poésie anglaise, le besoin de formuler ma pensée avec précision. En moi, la raison est la vice-reine de Dieu. Je tiens compte de tout, jusqu’au moment où les décimales, derrière la virgule, se mettent à bégayer. » (Barnard 2023b) Après tout, en Angleterre, la vie ne se résume-t-elle pas à un match de cricket dont Dieu est l’arbitre ? (Barnard 2023c) Cette vie est aussi, bien souvent, synonyme de simple bonheur dans une campagne où l’on côtoie au quotidien des gens cultivés et débordant d’humour avec lesquels il est possible de parler littérature, musique, histoire, famille royale, et de partager le rituel du thé, un bon repas, les rites religieux… De tout bonnement entonner, à la fin d’un dîner, tandis que les dernières bûches se consument dans la cheminée, des chants ancestraux. Ou de célébrer, au cœur du village, en pleine pandémie, alors que tout rassemblement est interdit, le Remembrance Sunday, les coquelicots en papier fleurissant, contre vents et marées médiatiques, sur les poitrines. La Grande Guerre ayant marqué plus que tout les Britanniques, le Néerlandais commémore avec ferveur l’Armistice. Transposition d’un tel moment par le poète13 :
Soldat de deuxième classe Richard Hodd († 18.9.1916)
Tu t’engages, la porte de l’écurie des Flandres s’ouvre :
soldats dociles qui tombent à l’horizon – sur la crête
d’une colline qui non sans mal se dresse, tu vois une épouse
marcher dont le mari mort au combat faisait tourner les ailes
du moulin pas encore canonné ; ses jupes dissimulent
le feu qui va bientôt s’embraser, dès que tu seras là-bas ;
le cul vivant du cheval devant la charrue qu’elle mène
représente les zéros des chiffres qu’à l’origine l’état-major nie.
Tu aurais pu en faire partie, garçon de ferme, mais la peur
t’a paralysé au moment du départ : aucun Jésus ne t’a sauvé
de toi-même quand tu t’es engagé ici dans la rivière. Oh ! ça !
ce village ne t’oubliera pas tout à fait, tu y as une tombe,
une prière le 11 novembre ; l’Angleterre entière
un In memoriam. La nuit, tu rues avec rage dans l’écurie.
Sans doute une citation empruntée au Vague étranger restitue-t-elle mieux que toute tentative d’exégèse ou toute paraphrase la teneur du propos de l’écrivain, les confluences qu’il décèle entre passé, présent et futur, entre impérissable poésie et prosaïque quotidien, entre ce que lui inspirait l’Angleterre un demi-siècle après qu’il y avait fait ses premiers pas et prononcé ses premiers mots :
Dieu habite en Angleterre – il est, comme on le sait, de surcroît citoyen britannique. Aucune star de la pop ne possède autant de maisons que lui, lui qui habite plus ou moins en même temps dans ces innombrables briques. N’est-il pas omniprésent, ubiquitous – un de ces mots grâce auxquels la bouche anglaise se met à parler latin. Mais là où il habite plus encore qu’ailleurs, c’est dans une timide église de campagne, cernée par une garde endormie de pierres tombales où l’inintelligible vie se rapporte à l’inconcevable non-vie comme l’organique à l’inorganique, comme les hautes herbes – nourries de la chair couvrant des os dont plus âme qui vive ne se souvient – aux pierres et aux mots. Ceci, tous les morts se le remémorent puisque le secret de la rédemption n’est rien d’autre que le souvenir – aucun institut ne s’occupe aussi frénétiquement du souvenir que l’Église, à moins que ce ne soit la littérature. (Barnard 2009 : 117)
•
Benno Barnard en français
Le Naufragé, recueil de poèmes, traduit du néerlandais par Marnix Vincent, Le Castor astral, 2003 (édition bilingue) ; Fragments d’un siècle. Une autobiographie généalogique, traduit du néerlandais par Monique Nagielkopf, Le Castor Astral, 2005 ; La Créature : monologue (théâtre), traduit du néerlandais par Marnix Vincent, Le Castor astral, 2007 ; Le Service de mariage, recueil de poèmes, traduit du néerlandais par Daniel Cunin, Le Castor Astral, 2019, « Les Passeurs d’Inuit ».
On trouvera dans différentes revues des poèmes traduits par l’auteur du présent article : dossier « 10 poètes néerlandais », présenté par Benno Barnard, Inuits dans la jungle, Le Castor Astral, juin 2015, n° 6, p. 77-85 ; « Poèmes », Deshima, n° 11, 2017 ; cahier « Poésie néerlandaise », Nunc, n° 47, printemps 2019, p. 79-81 ; le cycle « Hors de soi » dans la forge, n° 2, février 2024, p. 16-25. Et d’autres encore dans l’anthologie bilingue Poésie néerlandaise contemporaine, Le Castor Astral, 2019, p. 24-35.