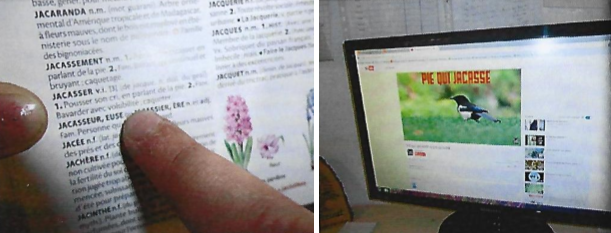Dire où se trouvent les étants « corbeau » ou « rizière », et pourquoi ils sont là plutôt qu’ailleurs, c’est ce dont s’occupent les géographes. Ils montrent que l’un et l’autre de ces étants font partie d’un certain paysage, analysable en termes d’écosystèmes, de structures agraires, de circuits de distribution, etc. ; toutes questions qui ne laissent pas la moindre place à une interrogation sur l’être. Pour un philosophe, en revanche, de telles considérations ne feraient qu’encombrer la question de l’être, plus gratifiante que d’inventorier le capharnaüm des étants. L’ontologie n’a que faire du rapport entre corbeaux, rizières et grenouilles.
Augustin Berque1.
Introduction
C’est derrière une fenêtre que fut inventé le sujet occidental moderne, c’est-à-dire rien de moins que la certitude première au fondement de toute certitude. C’est derrière une fenêtre, dans l’expérience vécue d’une méditation en passant l’épreuve vertigineuse, méthodique puis hyperbolique, du doute, que fut conçu et entrepris le projet d’offrir aux hommes l’indubitabilité d’un fondement qui résiste à toute incertitude. C’est derrière une fenêtre que l’évidence première du cogito en tant qu’autoconstitution de la subjectivité transcendantale fut l’énoncé d’une promesse, celle d’un horizon nouveau garantissant la stabilité du réel anthropologique dans sa prétention à la vérité comme dans son aspiration à la liberté pratique. Cet horizon, ressaisi par le géographe philosophe Augustin Berque2 sous le nom du paradigme occidental moderne classique (Berque, 2010), commande encore profondément la réalité de notre réel anthropologique.
Pourtant nous faisons bien l’expérience d’une incertitude inédite, nous sommes les témoins d’un monde où se multiplient les crises qui insécurisent mais surtout confinent nos existences, individuelles et collectives, à l’intérieur de limites toujours plus étroites. Encore récemment durant la crise sanitaire, consigne fut donnée de nous retrancher dans nos appartements derrière nos fenêtres jusqu’à dissoudre le sens du lien social, jusqu’à compromettre l’avenir de certains métiers au mépris de leur valeur patrimoniale, jusqu’à fragiliser le droit des enfants à une éducation scolaire. Et cet inventaire n’épuise pas la longue liste des préjudices. Et nos fenêtres d’écran, sous système d’exploitation Windows, n’ont su protéger ni la continuité économique de nos nations ni le circuit de nos relations. Nous nous sommes rencontrés, par écrans interposés, dans l’illusion d’un déloignement nous habituant à nous vivre malgré la distance et oubliant comme une fatalité la valeur d’une étreinte amicale, l’hospitalité d’une poignée de main, le privilège d’une question adressée à son professeur en sortant de l’amphithéâtre, le droit inaliénable de visiter ses malades et de les soutenir avant leur irréversible absence.
Une crise écologique sans précédent repose aussi à nouveau frais le sens d’une vie humaine et d’une humanité rythmées par la quête de certitude. Alors que l’âge de la Terre est justement rebaptisé du nom de l’homme, celui-ci n’a jamais autant vécu le rétrécissement de son monde habitable. L’appauvrissement exponentiel, quantitatif et qualitatif, de notre biodiversité jusqu’à la prévision d’une Sixième extinction, la raréfaction annoncée et déjà amorcée des ressources en eau par multiplication des périodes et des sites de sécheresse préoccupante, les bouleversements climatiques et leur retentissement sur la répartition des populations mondiales, n’ont pourtant pas découragé notre idéal de maîtrise. Là encore la rationalité galiléo-cartésienne ne renonce pas à ses prétentions sur l’avenir et anticipe des fenêtres de prévision justifiant le calendrier de stratégies technologiques toujours plus dévastatrices. Le caractère anticipateur des scénarios du GIEC3, aussi sincère soit-il, ne fait pas exception à cette norme prospective de la pensée techno-scientifique. Nous devrions donc nous résigner à poursuivre notre activité extractiviste pour garantir le développement d’énergies aussi propres et durables que le nucléaire et la batterie de voiture électrique.
Partout et plus que jamais nos environnements saturent donc de ces fenêtres cartésiennes, structurant notre géographie quotidienne, qui déçoivent et plus encore trompent ce désir d’une réalité sous contrôle que bien des générations ont incorporé comme l’ethos même de la vie contemporaine. Une vie sans problème, sans guerre, une vie qui par-dessus tout ne doit manquer de rien sur une Terre à la disposition de l’homme et de ses besoins. C’est donc en cet endroit que se précise l’identité du problème que nous souhaiterions situer au centre de cette interrogation sur la forme scolaire, ses institutions didactiques et leurs pratiques. Précisons-en un peu les termes. Dans ce monde en crise la question éducative pourrait être, comme elle l’est d’ailleurs le plus souvent, posée de la manière suivante : comment l’école peut-elle préparer les générations futures à vivre dans un monde devenu incertain ? Si la vocation de l’école est bien de préparer les enfants à entrer dans le monde, quoi de plus logique que d’attendre en effet de cette école qu’elle redéfinisse son action dans un monde en pleine mutation. Mais cette question laisse dans l’angle mort une partie du problème faute de problématiser l’incertitude que nous traversons. De quelle incertitude parlons-nous ? D’abord, et de toute évidence, de celle que nous produisons par l’excès ou la négligence de nos comportements comme de nos activités. L’homme est l’artisan de son insécurité et c’est ce que ressaisit parfaitement le concept heuristique d’anthropocène (Crutzen & Stoermer, 2000). Nous déstabilisons ou plutôt instabilisons le réel de l’espérer et de le vouloir stable.
L’école doit donc assumer la difficulté de ce paradoxe en évaluant d’abord sa complicité avec le paradigme occidental moderne classique et sa participation à la reproduction d’un modèle de déshabitation. Il s’agit alors de comprendre comment la promesse moderne de certitude a pu s’inverser en production d’incertitude. L’ambition de l’école ne peut se limiter à la survie des jeunes générations dans un paradigme au bord de l’impasse. C’est bien pourtant ce qu’elle se contente de faire en limitant son action à de vagues slogans sur le développement durable et à quelques programmes dépassés de sensibilisation au tri sélectif. « Durable » ne signifie pas autre chose que la prétention de l’homme à durer dans un système de civilisation dont la durabilité même se trouve être une impossibilité écologique, sociale et économique. L’école doit prendre en charge la responsabilité d’une bifurcation vers une manière absolument autre d’habiter capable d’assurer le legs de la culture sans menacer l’héritage de la Terre. Sa responsabilité passe donc plus radicalement par la reconstruction de sa forme scolaire d’éducation (Go, 2007, 2014). Elle doit bifurquer dans la bifurcation, ce qui revient à dire que sa bifurcation est la condition de toute transformation possible. La tâche à venir de l’école est donc d’abord de se réinventer, c’est-à-dire autant d’agir que de prendre acte de ce qu’elle doit cesser de faire en agissant pour commencer sur ses propres institutions didactiques.
Que doit-elle donc cesser de faire ? Là encore il faut se ressaisir pleinement du problème et comprendre toute l’ironie du paradoxe que nous traversons. Il convient donc de reposer la question : de quelle incertitude parlons-nous ? Mais comment d’abord ne pas s’étonner de ce que nous redécouvrions l’incertitude d’un monde incertain ? Il n’est pas satisfaisant de nous limiter à cette idée que nous sommes les seuls auteurs de cette incertitude. Car comment pouvons-nous logiquement produire de l’incertitude ? Une action, surtout considérée collectivement à l’échelle d’une culture et d’une civilisation, reste toujours un programme d’action. Nous agissons en vue d’une certaine fin dans la direction d’un projet, que ce soit un projet de loi, un projet industriel par exemple. Comment un programme d’action réglé sur des stratégies visant à réduire l’incertitude peut-il donc nous conduire à un dénouement si incertain ? Il n’y a qu’une seule réponse possible et nous touchons ici à ce qu’il y a de plus déconcertant dans ce paradoxe : le monde est en crise de ce que l’homme préoccupé par sa quête de certitude n’a justement pas su laisser de place à l’inattendu. Notre quête de certitude retrouve la réalité du réel dans ce qu’il convient d’appeler la résistance de l’incertitude. Nous redécouvrons l’événementialité du monde, c’est-à-dire le survenir même de son mode d’apparaître en son imprévisible spontanéité et contingence qui déborde les possibilités de notre conscience anticipante et son désir de prévision. Le problème nous oblige donc à faire un pas vers l’ontologie. Il faut prendre la mesure de ce qu’a pu impliquer pour nombre de générations le tournant transcendantal pris par la modernité et sa prétention à s’approprier jusqu’à l’avenir de ce qui advient. Avec la complicité de l’école et d’une forme scolaire encore dominante aujourd’hui, cette ontologie moderne a fabriqué une humanité déconcertée de s’être elle-même placée depuis sa fenêtre au centre de la marche du monde. Même notre langue porte l’empreinte sémantique de cette ambition en secondarisant, d’un préfixe privatif, l’in-certitude derrière son idéal anthropocentré de maîtrise. Et cette préséance logique de la certitude dans l’ordre de la langue et du discours reflète l’indexation ontologique de l’avenir sur la volonté humaine et son horizon d’attente dans l’ordre de l’être.
Ce qui se joue ici dans la grammaire de notre langue n’est donc ni plus ni moins que la négation et l’appropriation par l’homme de toute contingence de l’événement réal réduite et reconduite à un écart de notre réel anthropologique dévié de lui-même et de son style noétique en tant qu’horizon présomptif – et présomptueux – de ses attentes. La crise vient donc en quelque sorte de ce que la contingence comme caractéristique de l’inanticipable a justement été réduite à l’incertitude. Elle reflète le credo de la modernité et son refus de reconnaître dans l’événement l’excès de la transcendance en son absolue effectivité sur notre aptitude à prédire le cours des choses pour inverser son sens d’être en simple défaut de certitude et d’anticipation sur lequel la science promet toujours de reprendre le contrôle. Peut-être sommes nous en crise de redécouvrir la temporalité essentielle de l’avenir que nous n’avons cessé de vider « de son sens le plus essentiel : sa futurition même » et de soumettre à notre conscience-d’avenir « faisant de l’avenir un simple aspect ou moment de celle-ci » (Lavigne, 2015, p. 5-14).
L’école doit donc, en même temps qu’elle se réinvente, inventer la possibilité d’un décentrement anthropologique qui laisse enfin une chance à la spontanéité même inimaginable des phénomènes. Elle doit travailler à la défenestration de ses institutions didactiques. Il s’agit alors de comprendre comment faire de l’inattendu et de l’imprévisible, aux marges mêmes de l’anthropos, l’opportunité d’une nouvelle puissance d’agir capable de s’accorder à cette disruptivité de l’événement. Ce sont ces questions que nous soumettons à l’analyse mésologique à partir notamment de l’œuvre berquienne.
La fenêtre de Descartes : forme scolaire et paradigme occidental moderne classique
Nous disions que Berque avait su ressaisir la valeur historiale du paradigme galiléo-cartésien, c’est-à-dire sa vocation à se constituer en histoire en ouvrant l’horizon d’une histoire nouvelle marquante pour des générations à venir comme pour l’avenir de notre écoumène d’abord comme « demeure (οἶκος) de l’être de l’humain » (Berque, 2010, p. 17). Et il est difficile de comprendre la possibilisation de cette modernité sans envisager le rôle de l’école dans l’institution comme dans la reproduction d’un modèle scientifique promu au statut d’ethos (ἦθος). Car
géométriser la terre selon des formes proportionnelles, cela n’est pas qu’affaire de compas et de bulldozer ; il faut pour cela maîtriser les gens à qui on les impose, et qui tiennent à leur monde. La pureté de la forme, et son échelle, sont donc fonction de la tyrannie
(Berque, 2010, p. 117).
Plus qu’une simple doctrine philosophique et épistémologique, ce paradigme est parvenu à commander l’ensemble de nos usages et de nos comportements quotidiens en reconfigurant radicalement les habitudes qui structuraient jusqu’alors la perception du réel et son commerce avec les choses de l’homme prémoderne. Il convient donc d’éclairer cette co-détermination du paradigme occidental moderne classique et de l’école de telle sorte que celle-ci est instituante d’un rapport au monde autant qu’instituée par ce dernier. Si nous lisons d’un regard neuf un passage souvent commenté du Discours de la méthode, il ne peut nous échapper que s’y dessine, au moins en pointillés, une ambition bien réelle pour l’école :
Mais, sitôt que j’ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j’ai remarqué jusques où elles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s’est servi jusques à présent, j’ai cru que je ne pouvais les tenir cachées, sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu’il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on n’en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la Nature »
(Descartes, 1637/1992, p. 80)4.
La vision cartésienne révèle ici ce qu’il convient d’appeler un projet d’habitation servi par une science nouvelle que l’école aura pour mission de transmettre. Mais cette science doit d’abord trouver l’assurance d’un fondement dans la métaphysique que le projet des Méditations s’emploiera à lui conférer. La question est donc pour l’instant la suivante : comment définir cette ontologie cartésienne qui a donné à l’école cette forme moderne qu’elle conserve encore aujourd’hui ?
Cogito cartésien et principe du mont Horeb
Retournons un instant chez Descartes derrière sa fenêtre pour éclairer, de manière un peu inhabituelle, le sens de cette ontologie cartésienne à la lumière de sa géographie en montrant comment la quête cartésienne de certitude demeure solidaire du traitement particulier qu’elle réserve au sens d’être du lieu. Que se passe-t-il donc derrière la fenêtre de Descartes dans un passage emblématique de la seconde méditation, juste au cœur du paradigme non moins célèbre de la cire ?
[…] si par hasard, je ne regardais d’une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même que je dis que je vois de la cire ; et cependant que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux, qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes feints qui ne se remuent que par ressorts ? Mais je juge que ce sont de vrais hommes ; et ainsi je comprends, par la seule puissance de juger qui réside en mon esprit, ce que je croyais voir de mes yeux
(Descartes, 1641-1642, 1647, 1992, p. 87-89).
Pour repérer l’enjeu mésologique de cet extrait, il convient d’abord de le resituer, au moins succinctement, dans le parcours du sujet méditant ouvert par Descartes depuis la première des Méditations. Pour fonder son projet d’une science absolument certaine, c’est-à-dire « établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences » (Descartes, 1992, p. 57), Descartes se livre, en même temps qu’il invite son lecteur à suivre le même exemple, à une expérience radicale qui dépasse les ambitions simplement physiciennes du Discours5. Les Méditations reconduisent bien l’insatisfaction canonique de l’auteur à l’égard des opinions reçues en sa créance et la nécessité de suspendre tout jugement sur les opinions même douteuses issues des sens par le contact direct avec les objets du monde ou des sciences par l’incorporation des savoirs provenant également des objets mondains. Mais la nécessité de fournir aux sciences l’indubitabilité d’une évidence première ne peut donc venir des sciences elles-mêmes neutralisées par la vigilance méthodique et hyperbolique du doute mais que par l’intonation métaphysique du doute lui-même qui pose à nouveaux frais le problème de l’incertitude dans les termes de l’ontologie. Le doute ne peut en conséquence que subir une mutation existentielle au sein d’une expérience méditative et spontanée et suspendre jusqu’à l’existence même du monde, c’est-à-dire du lieu même dont proviennent les opinions douteuses et qui en est le dénominateur commun. Si rien ne garantit en effet la correspondance entre l’ordre de la réalité et le plan de mes représentations, c’est que rien n’atteste de l’existence même de la chose se maintenant hors de moi au titre d’un en soi. Le doute ne peut que s’élargir, jusqu’au point de rupture, de la méfiance envers ma sensibilité jusqu’à la défiance à l’égard même de la chose sensible justifiée par la possibilité passive du rêve et l’hypothèse volontaire du Malin Génie. Et la vigilance sans aucune concession de Descartes s’exprime sur ce point sans la moindre ambiguïté :
Car assuré que cependant il ne peut y avoir de péril ni d’erreur en cette voie. Et que je ne saurais aujourd’hui trop accorder à ma défiance puisqu’il n’est pas maintenant question d’agir, mais seulement de méditer et de connaître
(Descartes, 1992, p. 67).
Ce point de départ déconstructeur jusqu’à l’annihilation qui place le lecteur face à un « désert intégral » (Gress, 2012) fait du cycle des Méditations rien de moins qu’une entreprise ontogénétique et cosmogénétique par laquelle le soi, les choses et le monde sont progressivement restitués à l’existence sur le fondement d’une vérité première inébranlable vécue et aperçue dans l’expérience du cogito.
Mais ce geste cartésien ne va pourtant pas de soi et se trouve être lourd de conséquences. Loin d’établir l’assurance d’une place stable au sein du monde, il ne fonde l’existence humaine que sur la condition d’une rupture d’appartenance dont même la phénoménologie husserlienne et ses continuateurs après Descartes ne parviendront pas à surmonter l’aporie en dépit de l’établissement de la structure intentionnelle de la conscience qui avait jusqu’alors été manquée par la métaphysique cartésienne. La restitution du monde ne peut se faire que sur le jeu d’une inversion radicale qui indexe la ratio essendi des choses du monde sur la ratio cognoscendi du sujet pensant. S’inaugure donc avec le cogito cartésien l’histoire d’une falsification intellectualiste de la réalité puisque la réalité certitudinaire (Beaufret, 1998, p. 154) du réel cartésien ne peut s’originer que depuis la faculté de juger de la chose pensante conquise comme la première et la plus indubitable des certitudes et depuis laquelle seule toute vérité ne peut être suivant l’ordre des raisons que chose déduite. La mondanéité du monde, c’est-à-dire le principe à partir duquel le monde se constitue comme monde en tant que tel, est l’œuvre permanente d’une démondanéisation puisque je ne peux reconquérir la certitude des choses du monde que depuis la certitude d’une vérité conquise hors du monde. Ce qui signifie que je ne peux être sujet de ce monde qu’à la condition de pas être chose dans le monde. Habiter le réel cartésien ouvre en réalité un horizon de déshabitation.
Et ce paradoxe n’échappe pas à Berque qui ressaisit ce projet cartésien comme la seconde étape – après l’événement du Dieu du monothéisme – de ce qu’il institue au sein du glossaire mésologique comme le principe du Mont Horeb (Berque, 2018). Que signifie donc ce principe à l’œuvre dans la métaphysique cartésienne et dans quelle mesure inaugure-t-il l’histoire de notre habitation moderne ? Commençons par laisser la parole au géographe avec un extrait de la conférence donnée par Berque le 15 mai 2017 devant l’association Opera Mundi à Marseille :
Première étape : au xiiie siècle avant J.C, pour la première fois au monde, est pensé un être absolu. Cet être-là existe en lui-même, c’est la substance absolue, abstraite de toute relation. Il s’agit du Dieu du monothéisme, tel que la Bible (Exode, 3, 13-14) rapporte sa manifestation sur le Mont Horeb – je parle donc à ce propos de « principe du Mont Horeb » – où Yahveh, s’adressant à Moïse, prononce le fameux « je suis celui qui suit », « je serai qui je serai », « je suis l’étant ». Autrement dit, transcendant à la fois tout empirie et toute logique, cet être-là est à la fois sujet et prédicat de lui-même. Il n’a besoin de rien d’autre que de lui-même pour être ce qu’il est […] Deuxième étape : au xviie siècle apr. J.-C., avec le cogito cartésien, c’est cette fois-ci directement à lui-même que l’être humain applique cette abstraction transcendantale […] À partir de cette prise de conscience du sujet moderne, désormais seul détenteur d’une identité subjective – c’est-à-dire de la subjectivité : le fait de ne pas être un objet […] c’est bien celle d’un être qui, à la différence de tous les autres, n’a besoin que de lui-même pour être ce qu’il est. Tout le reste n’est donc plus qu’une mécanique objectale, à ce titre essentiellement distinct de lui-même
(Berque, 2017, p. 3-4).
Ce principe n’est autre donc que celui du tour de force par lequel la métaphysique cartésienne procède au renversement complet du réel pour faire de la conscience le lieu originaire depuis lequel s’origine la totalité des lieux. L’expérience transcendantale du cogito, dans laquelle je m’atteste moi-même à même l’acte performatif de penser comme présence immédiate à soi, scelle avec l’énoncé du je suis, j’existe (Descartes, 1992, p. 77) la prétention à l’autonomie ontologique de l’homme moderne. La réflexivité du sujet conscient cesse de se penser comme un produit du monde et de ses milieux et s’auto-institue comme l’événement de la subjectivité libre dans un environnement d’objets6. C’est ce que montre l’extrait de la fenêtre sur lequel nous pouvons revenir à présent en reposant une nouvelle fois la question : que se passe-t-il chez Descartes derrière sa fenêtre ? Mais ce premier examen des Méditations autorise déjà une reformulation de la question. Comment Descartes met-il donc en œuvre ce processus de décosmisation depuis l’expérience première de la subjectivité transcendantale ?
Petite phénoménologie mésologique de la fenêtre cartésienne : la forclusion du lieu
Depuis sa fenêtre Descartes voit passer dans la rue des hommes vêtus de chapeaux et de manteaux. Mais il se ravise immédiatement pour orienter notre attention vers ce qu’il repère comme un abus du langage ordinaire. Le doute poursuit ainsi son œuvre méticuleuse puisqu’il se déploie à présent vers le langage par lequel s’exerce l’acte philosophant. Et le doute lui fait ici apercevoir ce qui n’est qu’une précipitation langagière. Il dit qu’il voit des hommes passer dans la rue. Or sa vue ne lui donne que la perception de chapeaux et de manteaux qui pourraient ne masquer que « spectres » et « hommes feints ». Si Descartes peut affirmer pourtant que ce sont bien des hommes, alors qu’aucune sensation ne peut l’attester, c’est qu’il énonce un jugement. Que faut-il donc comprendre de cet extrait ? Que la condition de possibilité de toute perception ne se tient pas dans la vie sensorielle et dans l’exercice de mes sens mais dans l’intellection, c’est-à-dire dans un acte de l’entendement par l’exercice de ma faculté de juger. L’extrait redouble d’abord dans une démonstration par l’exemple le caractère trompeur des sens, thématisé dans la première Méditation, desquels proviennent nos opinions douteuses. Il confirme en même temps l’originarité de la conscience jusque-là simplement aperçue et vécue dans la solitude de cette présence à soi du cogito pour être à présent vécue, même intellectuellement, dans l’épreuve esquissée et encore provisoire d’un retour au monde. Mais ce retour au monde prend déjà la voie d’une bifurcation puisque la secondarisation du monde derrière la préséance ontologique du sujet conscient y est définitivement affirmée. Et le passage du morceau de cire à la fenêtre ne peut plus être l’expression d’un choix fortuit puisque Descartes nous fait ici cheminer du simple objet « cire » et du monde de l’objet – du moins ce qu’il en reste – vers les objets du monde dans la réalité catégoriale d’un état-de-choses « hommes qui passent dans la rue ». Autrement dit le processus méthodique du doute et son œuvre de reconfiguration s’élargit au monde en son entier.
Mais Descartes franchit surtout une nouvelle étape en indexant la perception sur l’entendement et les actes volontaires de la faculté de juger. Il neutralise ici la dimension passive du sujet, c’est-à-dire ce circuit par lequel mon être est, même à son insu, affecté par les choses du monde pour faire de la réalité une fabrication intellectuelle du sujet pensant. Il ne peut d’ailleurs en être autrement d’une conscience qui a révoqué en doute jusqu’à l’expérience de son incarnation définitivement perdue dans le dualisme entre res cogitans et res extensa acté par la sixième et dernière Méditation. La subjectivation du sujet s’actualise à proportion de ce que la conscience se désapparie du lieu corporel thématisé comme le foyer de nos préjugés et de notre disposition à l’erreur, c’est-à-dire par la réduction définitive de la chair vivante et sentante (Leib) au corps objectif (Körper). Ce partage qui s’origine donc dans le sujet ne peut être que reconduit vers un nouveau partage qui divise le monde en deux pôles subjectif et objectif. Cette invention de l’objectivité signe l’acte de naissance de la modernité.
Et l’exemple cartésien de la fenêtre ne peut être le fruit d’une simple coïncidence tant il emblématise comme un paradigme sur mesure de la modernité l’écart ontologique qui s’est ici creusé entre l’homme et le monde. Car au fond la question peut être posée : qu’est-ce qu’une fenêtre ? La réflexion doit assumer ce parti pris des choses pour éclairer le lien organique qui noue la gestation d’une ontologie nouvelle au destin littéraire d’une banale fenêtre car il suffit « de fixer son attention sur le premier objet venu » pour s’apercevoir « aussitôt que personne ne l’a jamais observé, et qu’à son propos, les choses élémentaires restent à dire » (Ponge, 1948, 2020, p. 173).
Il faut donc d’abord souligner une certaine ambiguïté phénoménologique de la fenêtre7. D’un côté son être consiste dans cette trouée percée dans la cloison qui libère un horizon de visibilité sur les choses du monde. Elle apparaît en même temps qu’elle fait paraître une perspective dans l’originalité matérielle de sa transparence ou plutôt elle disparaît à même son apparition pour laisser apparaître un point de vue sur le monde. Dans ce trait consiste en quelque sorte sa chôra de fenêtre qui la constitue à la fois comme empreinte et matrice (Berque, 2010, p. 31). Son topos se tient dans l’encadrure géométrique qui délimite la forme de son objectité au sein de la cloison et détermine ma position objective dans l’espace quand je regarde par la fenêtre face à ce point de vue – sur le quartier, sur la rue et ses passants ou ses automobiles, sur ses arbres et ses bancs publics – que m’offre sa présence. Mais son lieu ouvre un déploiement possible qui implique ma sensibilité dans le tissu relationnel des choses (ibid., p.150). Comprendre ce déploiement écouménal (ibid., p. 159) par lequel je viens en présence des choses revient donc à ressaisir la manière dont elle m’implique dans cela même qu’elle me donne à voir. Nous serions tentés de répondre, et c’est là notre hypothèse directrice, que c’est justement en m’installant dans la précarité du monde. La fenêtre ne libère pas seulement une perspective mais elle m’institue en perspective sur le monde. Les limites de son encadrure font apparaître en même temps ce que je ne suis pas en mesure de voir et cette lacunarité perceptive qui est le corrélat même de mon appartenance et de mon incarnation. Husserl a parfaitement ressaisi cette loi d’essence de l’acte perceptif qui ne se déploie dans la profondeur du sensible que sous la forme d’une donation par esquisses (Husserl, 1913). En même temps le mérite revient à son continuateur Patočka d’avoir montré que ce procès perceptif ne progresse qu’à mesure de ce qu’il demeure en défaut sur la continuabilité objective de l’expérience (Patočka, 1995 ; Barbaras, 2019, p. 87-89)8. Et la fenêtre exacerbe cette carence perceptive du fait que ma mobilité s’y trouve réduite sans pouvoir pénétrer davantage dans le courant des choses. Elle me rend à mon existence trajective (Berque, 2010) qui remet à chaque fois en jeu mon attention et mon imagination dans ce flux instable de l’expérience. Aussi la médiance comme « moment structurel de l’existence » (Watsuji, 1935, 1979, p. 3) consiste-telle dans cette aptitude à vivre avec cette instabilité de l’apparaître dans un dialogue constant avec l’inconstance des milieux. Reconnaître le parfum volatile d’une passante dans la rue ou l’essence d’un bois brûlé dans un feu de cheminée, évaluer l’endurance d’un joggeur qui file d’une allure rapide sur le trottoir, identifier le chant d’un oiseau qui s’envole dès que j’approche.
[…] il faut s’attacher à ce en quoi la chôra peut-être un lieu géniteur ; c’est-à-dire une ouverture à partir de laquelle se déploie quelque chose, et qui justement ne limite et ne définit pas
(Berque, 2010, p. 32).
La fenêtre déploie donc son lieu cosmophanique de ce que je suis sans cesse contraint de me réaccorder à la mobilité spatialisante et temporalisante des choses pour vivre au rythme du réel. Derrière la fenêtre de Descartes les choses se passent tout autrement. Car
Descartes déteste l’incertitude. Ce qui tient l’esprit en suspens lui déplaît. Rien ne lui est plus étranger que la notion de degrés dans l’assentiment
(Alquié, 2017, p. 60).
Le caractère lacunaire de la perception ne lui échappe évidemment pas dans le passage de ces hommes vêtus de manteaux et de chapeaux mais c’est aussitôt pour la surmonter dans un renversement inattendu en neutralisant le circuit passif de la perception au profit du jugement volontaire. La fenêtre révèle alors un autre versant de son être qui reçoit la préférence de Descartes. Si elle ouvre une perspective, c’est une perspective fixe dans le mouvement « du flexible et du muable » comme ce point fixe d’Archimède recherché depuis le début de la seconde Méditation (Descartes, 1992, p. 85)9. Elle apporte la permanence dans l’impermanence du monde pour devenir le lieu stable de l’identité dans le temps éternel de la substance. La chôra de la fenêtre cartésienne s’épuise dans sa topicité parce qu’elle est le lieu depuis lequel la perspective s’inverse en absolu. Ce geste cartésien d’universion (Berque, 2010, p. 101-105) par unification du divers sensible a deux conséquences majeures. D’une part il justifie en métaphysique la neutralisation des qualités secondes en direction d’une géométrisation du monde réductible à l’étendue et vu comme un grand livre écrit en langue mathématique. Husserl a bien ressaisi dans le célèbre § 9 de la Krisis la compatibilité de l’objectivisme galiléen avec le subjectivisme cartésien qui apporte avec le cogito un fondement durable au projet d’objectivation du réel (Berque, ibid., p. 142). D’autre part et corrélativement il confirme après Galilée la possibilité d’une abstraction calculable et prévisible du réel où, comme depuis la « fenêtre » de Rilke, « tous les hasards sont abolis » (Rilke, 1924-1925).
Nous ne connaissons que trop bien les conséquences désastreuses de ce tournant moderne dont la reproduction jusqu’à aujourd’hui a pour condition de possibilité la complicité de nos institutions scolaires. Il faut donc, maintenant que se trouve un peu plus éclairée l’ontologie cartésienne et son influence sur le sens d’être du lieu, se poser la question de ce que cette réforme cartésienne de l’ontologie a depuis commandé à l’école de faire. Quel projet de savoir et de transmission détermine-t-elle au sein de la forme scolaire et en direction de quelle réforme de l’humain détermine-t-elle encore aujourd’hui le programme de l’école ?
Derrière les fenêtres de l’école : une ontologie de la peur
L’inconscient cartésien ou la puissance de la peur
Que se passe-t-il donc derrière les fenêtres de l’école ? Pour répondre à cette question il ne nous faut pas encore prendre totalement congé de Descartes. Nous avons défini l’ontologie cartésienne comme le projet fondateur d’une nouvelle réalité désormais assise sur l’indubitabilité d’une évidence première et originaire. Mais c’est oublier ici qu’elle est elle-même fondée sur un désir de certitude. Il apparaît donc que le fondement constituant d’une nouvelle conception du réel est déjà lui-même fondé parce que rattrapé et anticipé par l’activité irrépressible d’un désir de stabilité. Il est possible de rétorquer que ce désir est contemporain du geste, celui du doute, dans lequel il s’accomplit. Mais si cette objection reste juste, elle laisse encore impensée l’origine même de ce désir. Pourquoi donc cette obsession cartésienne, jusqu’à la compulsivité, de certitude ? Thibaut Gress apporte avec une thèse nouvelle sur l’œuvre de Descartes l’élément manquant de la réponse :
Ce qu’il y a de premier chez Descartes, ce n’est pas la certitude selon laquelle il faut douter du monde, c’est-à-dire des connaissances sensibles, des impressions ou des savoirs reçus, mais bien l’expérience de l’extrême précarité de ce qui nous entoure. Sans cette expérience inaugurale, sans ce sentiment d’insécurité foncier que procure le monde, sans cette impression d’inconsistance radicale du monde qui nous laisse nus et esseulés, nous ne pouvons guère pratiquer le doute de manière efficace. En d’autres termes, ce que nous voulons dire est que, s’il est exact que le doute constitue, du point de vue de la méthode, la première étape en vue de fonder une science certaine, il ne constitue pas pour autant l’expérience première requise pour philosopher
(Gress, 2012, p. 35-62).
Certes la certitude cartésienne s’établit sur la certitude de douter et de remettre en jeu les opinions ou les savoirs qui ne sont que l’héritage suspect de notre sensibilité. Mais le jeu cartésien demeure sans aucune concession, il ne négocie pas avec l’inconstance de nos idées mais l’annule tout bonnement et simplement. La nouvelle cosmophanie cartésienne, libérant de leur flexibilité hylétique l’étendue objective des choses du monde, a pour condition l’exécution d’un geste déconstructeur et proprement cosmoctonique par lequel le monde jusqu’alors reçu en ma créance est effacé (Berque, 2010, p. 41). C’est ici que se ressaisit la nature d’un doute qui ne cesse jamais d’être méthodique et qui n’a pour destination, au contraire du doute sceptique, que de s’annuler lui-même pour faire apparaître la stabilité conquise d’un nouveau monde. Néanmoins le doute cartésien reste toujours en retard sur sa provenance réelle qui est bien « l’expérience de l’extrême précarité de ce qui nous entoure » dans laquelle nous faisons d’abord la rencontre insupportable de notre nudité et de notre vulnérabilité. La méthode cartésienne consiste donc dans un double geste symétriquement et simultanément phénoménalisant et occultant : la stabilité noético-noématique du réel comme réalité reconquise par la subjectivité n’apparaît qu’à mesure que se recouvre la précarité objective du monde qui fonde comme sa raison objective la nécessité de douter (Gress, 2012, p. 35-62). Le dispositif méthodique cartésien est donc contaminé et précédé par un présupposé non thématisé qui commande le projet d’une ontologie sans préjugés.
Comprendre la forme cartésienne d’éducation nécessite donc d’élucider la nature de ce présupposé. Et cet angle mort, qui se soustrait à la vigilance d’un acte philosophant dévoué chez Descartes à la puissance de l’intellection, ne peut se trouver que dans le champ masqué de l’affectivité. Et cette hypothèse est rapidement confirmée dès les premières lignes de la seconde Méditation :
La méditation que je fis hier m’a rempli l’esprit de tant de doutes […] ; et comme si tout à coup j’étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris, que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus
(Descartes, 1992, p. 71).
Or qu’est-ce que l’affectivité si ce n’est d’abord cette disposition à être affecté par les choses avant toute forme d’acte volontaire, à être comme « surpris » par l’étrangeté de leur apparition. C’est par ce versant passif de ma sensibilité que je fais l’expérience concrète de cette précarité du monde rapatriée vers mon répertoire sensoriel. L’affect est le lieu de cette déhiscence si bien thématisée par Merleau-Ponty comme l’enroulement même de cette réversibilité constante et clignotante entre la chair sentante et la chair sentie (Merleau-Ponty, 1964, 2001, p. 199). Et la forme cartésienne de cet affect ne peut pas prendre d’autre forme que celle de la peur qui est le schème générateur et inconscient de toute la méfiance méthodique des Méditations. N’oublions d’ailleurs pas qu’en ancien français le verbe « redouter » est un simple intensif du verbe « douter ». Aussi peut-on requalifier l’ontologie cartésienne d’une ontologie de la peur. La redescription de cette métaphysique cartésienne sous l’angle d’une peur ontologique est riche d’éclaircissements. Et le mérite revient à Nietzsche d’avoir repéré le tout premier cette force existentiale qui se niche dans ce qu’il convient d’appeler une peur civilisationnelle typique de la culture occidentale.
[…] Cet impétueux désir de certitude qui se décharge, aujourd’hui encore, dans les masses compactes, avec des allures scientifiques et positivistes, ce désir d’avoir à tout prix quelque chose de solide […] est, lui aussi, le désir d’un appui, d’un soutien, bref, cet instinct de faiblesse qui, s’il ne crée pas les religions, les métaphysiques et les principes de toute espèce, les conservent du moins
(Nietzsche, 1887/2011, p. 185).
La métaphysique occidentale est l’histoire d’un exorcisme visant à neutraliser cette peur viscérale de l’incertitude10. Et l’originalité de Descartes tient dans ce que celui-ci radicalise le processus d’idéalisation du monde : il ne s’emploie pas seulement à neutraliser la peur de la précarité mondaine, il ambitionne d’annuler ce qui l’irrigue à sa source, à savoir la précarité du monde elle-même. Il convient d’ailleurs de ne pas oublier que cette métaphysique sert de fondement à une physique qui inspire encore notre culture techno-scientifique par laquelle nous nous donnons « la possibilité technique de nous déterrestrer enfin concrètement, non plus seulement par abstraction » (Berque, 2017, p. 4). Le cogito et son projet d’objectivation n’a pas d’autre fin en réalité que d’ouvrir l’horizon d’un sujet autosuffisant libéré de toute contingence et de toute dépendance à l’égard des milieux.
Mais ce qu’il convient ici d’apercevoir c’est que la puissance symbolique et technique du réel cartésien reste l’expression proportionnelle d’une peur qui œuvre en creux dans chacune de ses prescriptions. Telle est l’équation du réel anthropologique cartésien : autant de puissance, autant de peur. C’est pourquoi nous proposons de requalifier la forme scolaire comme forme tragique d’éducation. Tragique, dans un sens bien différent de celui de Nietzsche et plutôt ressaisi dans son sens ordinaire comme héritage de la poétique antique. Pourquoi ce rapprochement entre l’école et le tragique ? D’abord parce que l’idéal prométhéen promu par l’école depuis la modernité cartésienne ne pouvait que rencontrer dans les crises actuelles, comme un retour du refoulé, le dénouement inéluctable d’une peur occultée par un désir de maîtrise. Le monde est en crise de ce que le réel cartésien n’a pas su apprivoiser l’état fondamentalement problématique du monde refoulé dans une substruction géométrique du monde de la vie déjà dénoncée par Husserl au § 9 de la Krisis :
[…] Il est à présent capital de considérer la substitution – qui s’accomplit déjà chez Galilée – par laquelle le monde mathématique des idéalités, qui est une substruction, est pris pour le seul monde réel, celui qui nous est donné vraiment comme perceptible, le monde de l’expérience réel ou possible : bref, notre monde-de-vie quotidien. Cette substitution s’est transmise aussitôt chez les successeurs de Galilée, chez tous les physiciens des siècles suivants
(Husserl, 1936, 2019, p. 57).
Et, comme nous pouvons le déduire de cette réflexion de Maldiney, la forme moderne d’éducation s’origine dans cette crise inaugurale non dépassée :
La marque du pathologique n’est pas la crise mais au contraire son impossibilité. La répétition d’un état critique non dépassé empêche l’avènement de tout autre événement. Toutes les crises ne sont plus désormais que la répétition de la première qui s’entretient indéfiniment de sa propre irrésolution. Ce n’est pas la crise mais la forclusion de tout état critique qui constitue le pathologique
(Maldiney, 2001, 2014, p. 221).
Cette forme tragique d’éducation est donc la reproduction plusieurs fois séculaire du fait primitif de cette peur cartésienne. Il convient donc à présent d’évaluer les conséquences mésologiques d’une éducation confiée à une institution de la peur. Que se passe-t-il donc derrière les fenêtres de l’école ? La réponse est simple : l’école se cache. Elle travaille auprès des générations futures à la déconstruction d’un état problématique du monde en n’instituant pas autre chose que son procès de décosmisation. Et c’est là que le sens d’une forme scolaire tragique prend tout son sens puisque ce processus passe méthodiquement par la réduction du monde à une unité de lieu, une unité de temps et une unité d’action par laquelle nous désignons ici la forme de ses institutions symboliques. C’est par cette réduction que l’école scénarise ou arraisonne en le soumettant au régime de la raison (Heidegger, 1954) le sans pourquoi du monde pour faire des adultes futurs les acteurs d’un grand théâtre.
Unité de lieu : le procès de déshumanisation
Et ce théâtre commence derrière les fenêtres de l’école dont l’historien Michel Lainé nous rappelle leur participation à une conception hygiéniste et carcérale du lieu scolaire. Des consignes de 1834 données par l’architecte Bouillon puis confirmées en 1845 par le docteur Jacquey
préconisaient de le [le linteau des fenêtres] placer à une hauteur qui empêchât les élèves de voir depuis leur banc ce qui se passe à l’extérieur, car « la curiosité, beaucoup plus impérieuse dans le jeune âge que l’amour de l’étude, amène chez ces jeunes gens des distractions qui leur fait perdre bien du temps »
(Lainé, 1996, p. 141-142 ; Jacquey, 1845, p. 63)11.
Il suffit d’observer le paysage d’aujourd’hui pour constater avec évidence que la situation n’a pas changé. Le lieu scolaire reste cette caserne plus ou moins modernisée où le savoir se trouve sanctuarisé. Mais attardons-nous sur deux éléments significatifs de cette citation. D’abord la chasse à l’incertitude ne peut que commencer par la première des incertitudes : l’enfant lui-même et son enfance que Berque ressaisit justement comme l’expression intacte de notre lien natif avec les milieux, c’est-à-dire comme notre installation spontanée dans la concrétude des choses là où les gens, les mots et les choses grandissent ensemble selon l’acception la plus littérale du mot. C’est ce que dit son étymologie latine concretus, participe passé de concrescere : grandir ensemble (Berque, 2010, p. 23). Mais écoutons cette définition si bienveillante de l’enfance que nous propose le géographe :
Le petit enfant est un foyer en genèse de lui-même et des choses de son monde, indissociablement, dans le devenir unitaire où sa capacité de dire et sa capacité de faire croissent de pair avec son propre corps, à partir de l’état d’infans. Ainsi, les mots s’agrègent à sa chair comme une nature des choses, en une seule et même réalité, qui grandit avec lui comme se déploie son monde.
(Berque, 2010, p. 153).
Il faut bien comprendre l’aporie d’un lieu scolaire qui soustrait à l’enfant la condition même de son développement par la forclusion d’un monde jeté et enfermé dehors derrière la fenêtre (Berque, 2008). Et c’est là le deuxième aspect qu’éclaire la citation de Lainé. Dès son plus jeune âge, l’enfant doit apprendre à incorporer le vide dans un espace claustral sur mesure que l’école a fabriqué pour lui, celui de l’unique classe où cette discipline certitudinaire l’immobilisera durant une longue partie de son parcours biographique. Le déploiement écouménal de l’humain s’y inverse en déploiement érémitique qui n’est autre qu’un repliement dans le désert sensible de la classe où se joue l’apprentissage de l’autosuffisance cartésienne. La forclusion du corps médial par découplage du corps animal a pour ambition la rupture du circuit trajectif pour lui substituer une nouvelle structure d’habitualité par laquelle l’enfant s’habitue à cette illusion de pouvoir se passer du lieu. Fabrique d’amnésie où petit à petit l’enfant oublie cette épreuve fondamentale du là qui fait sa condition d’être jeté dans l’existence et dans laquelle seule il trouve pourtant à se possibiliser (Heidegger, 1927, 1985). Le scénario de la peur cartésienne se confirme ici puisque c’est par l’intonation affective (Befindlichkeit) du Dasein que celui-ci s’ouvre en son être-jeté et découvre « l’abordabilité » du monde, à savoir l’ouverture co-originaire de son être-là et du là du monde (ibid., p. 122). Aussi le refoulement de la peur ne peut-il conséquemment passer que par une forclusion de la médiance. L’enfant, rivé au sol de sa chaise vers la fenêtre opaque du tableau noir, apprend à raturer à la craie sa géographicité qui est le corrélat de son appartenance en effaçant l’origine terrestre qui le définit. Il faut donc souligner ici un paradoxe vertigineux : le lieu où s’institue l’humanité n’est autre qu’une fabrique de cyborgs où le jeune homme s’exerce à se déshumaniser en se déterrestrant (Berque, 2017, p. 4).
Unité d’action et fétichisme des institutions symboliques
Corrélativement la Terre s’efface de la langue dans ce qu’il faut appeler une carcéralité des institutions symboliques. Car l’enfant doit s’exercer à la sémiose d’un monde hors-sol désolidarisé de sa base terrestre par l’œuvre de cette substruction. La langue subit le même repliement dans un devenir idiomatique qui est l’expression autocentrée d’une langue scolaire déviée du monde pour pivoter en quelque sorte sur elle-même12. Par neutralisation du langage ordinaire, exactement sur le modèle du geste cartésien, l’école désolidarise le langage du circuit de l’expérience. La langue scolaire s’exerce sur l’élève avec la pression d’un totalitarisme ontologique où l’unique monde du langage se substitue au monde ordinaire de la communication et de la praxis, c’est-à-dire à ces systèmes symboliques par lesquels nous agissons dans le monde et avec les choses. Et Berque a ressaisi, non sans une certaine originalité, le commencement d’une histoire scolastique de la langue qui s’origine non dans le structuralisme et l’invention saussurienne de la linguistique mais bien dans le dualisme cartésien.
S’agissant de fétichiser le signifiant, nous n’héritons pas ce vice que du structuralisme ; il est essentiellement moderne. Avant Saussure, nous le devons en effet au dualisme cartésien, et avant celui-ci, à la conception aristotélicienne du lieu, qui consiste à en détacher l’être de ce qu’il contient. En l’affaire, à séparer ce lieu de sens, qu’est le signe, du sens qu’il a concrètement, c’est-à-dire au sein de l’histoire et du milieu singuliers où les gens, les choses et les signes ont grandi ensemble. Cette abstraction-là, privant le signe de ce que dit le signe, c’est à peu près ce que dénonce le proverbe chinois : le sage montre la lune et l’idiot regarde le doigt
(Berque, 2010, p. 43-44).
L’autosuffisance du sujet ne peut avoir pour corrélat qu’une redéfinition du sujet parlant instruit au métabasisme (Berque, 2008, p. 82) d’une grammaire emblématique des pratiques scolaires qui n’a pas d’autre préoccupation que les structures mêmes de la langue13. Telle est la fenêtre fermée d’un solipsisme langagier dont Berque n’a donc pas tort d’attribuer la paternité à notre cher Descartes. Par ce mouvement de la langue inverse des structures ekstatiques de la conscience, l’école invertit la structure attentionnelle des élèves pour accorder l’incertitude des choses au diapason d’une langue ressaisie dans son autonomie, c’est-à-dire encore une fois à son topos.
Unité de temps ou la « nostalgie du futur »
Mais il convient de ne pas oublier ce qui commande avec détermination cette forme moderne de l’école héritée du projet cartésien : la peur. Or qu’est-ce que la peur ? Nous pouvons nous en instruire auprès de Heidegger qui l’a si bien thématisée au § 30 d’Être et Temps. Retenons, pour ce qui nous concerne, qu’elle est d’abord « le devant-quoi de la peur », c’est-à-dire « le redoutable » qui « est à chaque fois un étant faisant encontre à l’intérieur du monde » et qui a « le caractère de la menace » (Heidegger, 1927, 1985, p. 124). La peur (Furcht) a donc cette particularité de se rapporter à un objet. Elle est nécessairement peur de quelque chose et s’éveille au mouvement d’approche d’un étant quelconque qui sort du lointain pour venir dans la proximité et nous menacer d’une façon ou d’une autre. C’est en cet endroit même qu’elle se distingue, continue Heidegger, de l’angoisse (Angst) qui, elle, n’a pas d’objet à proprement parler puisque ce devant-quoi l’angoisse s’angoisse n’est autre chose que l’être-au-monde lui-même en tant que le Dasein est reconduit à la totalité de l’étant et au monde qui apparaît dans sa radicale étrangeté (Unheimlichkeit). « Dans le devant-quoi de l’angoisse, nous dit Heidegger au célèbre § 40, devient manifeste le « rien et nulle part » puisque « le devant-quoi de l’angoisse est le monde comme tel » (ibid., p. 156). Mais alors, la peur cartésienne devant l’expérience de la précarité du monde ne relève-t-elle pas plutôt de cette affection qui signe l’originalité de l’angoisse ? Assurément. Mais l’angoisse n’est pas tant l’affect qu’elle suscite que ce moment d’assomption que le Dasein est mis en demeure de relever. C’est « la possibilité d’un ouvrir privilégié » en lequel se révèlent les possibilités propres du Dasein et la possibilité inédite de sortir de ce mode de l’échéance (Verfallen) et assumer la révélation de l’Être. Il ne faut pas douter de l’angoisse mais bien la ressaisir comme une opportunité. Or Descartes doute et le caractère profondément mondanéisant de l’angoisse, dans lequel surgit l’épiphanie du monde comme tel, s’infléchit à nouveau dans l’affect de la peur pour initier le plus grand procès de décosmisation de toute notre histoire occidentale.
Car, de même que la peur se donne pour urgence d’annuler l’objet de la menace, la peur cartésienne comme dévalement (Verfallenheit) de l’angoisse se fixe pour objectif l’annulation de toute forme de précarité. Elle absolutise en même temps que le doute la totalité du monde dans le caractère du menaçant. Aussi la déconstruction cartésienne s’élargit-elle des objets réels à tous les objets possibles du monde vécus comme la potentialité d’une menace. La peur cartésienne est une peur de la peur qui ne peut se dissiper que par la neutralisation de la possibilité même du monde. Et cette possibilité même du monde ne peut être autre chose que la temporalisation du monde qui est le surgissement temporel de sa possibilité dans l’effectivité des étants. C’est pourquoi le geste cartésien n’est pas autre chose qu’une mainmise sur le futur en son mode d’être le plus originaire, c’est-à-dire son procès même de futurition. Annuler le mode d’apparaître du temps en sa nécessaire imprévisibilité garantit la possibilité d’un monde prévisible et calculable en le libérant de toute forme d’incertitude. La forclusion du lieu et des milieux n’a donc pour ambition première que cet impératif de détemporalisation :
C’est dans le sens de cette spatialisation-détemporalisation-objectification du monde que l’on peut caractériser l’étape de la modernité comme un arrêt sur objet, ainsi qu’on parle d’« arrêt sur image » dans le langage du cinéma. Mais arrêt de quoi ? Arrêt du mouvement existentiel qui investit notre être dans les choses et de ce fait les humanise, tout en faisant d’elles, corrélativement la forme concrète de notre existence. Inversement, cet arrêt sur objet temporalisait-déspatialisait-subjectifiait absolument la conscience, en l’abstrayant non seulement de l’écoumène, mais même de la spatialité de son propre contenu
(Berque, 2010, p. 110).
Et c’est précisément ce travail que l’école accomplit dans ce que Sensevy a ressaisi comme le temps d’objet (Sensevy, 2011) qui est celui des programmes scolaires. Le programme est le paradoxe le plus déconcertant de toute l’histoire de l’école. Il crée du temps par anticipation des objets du savoir déroulés dans le temps d’une progression didactique, du connu vers le non connu. C’est bien ce que nous dit son étymologie grecque πρόγραμμα du verbe προγράφω lui-même composé du préfixe πρό « avant » et du radical γράφω « écrire ». Qu’est-ce donc qu’un programme ? C’est l’action d’écrire ce qui se passe avant que cela ne se passe. Programmer n’est donc rien d’autre qu’annuler la temporalisation du temps en son événementialité radicale. Le temps naturel n’est pas l’horizon des possibles mais bien hors de tout horizon présomptif l’impossible en son impossibilité même. Il est l’événementialité imprévisible du monde. Henri Louis Go a parfaitement ressaisi ce trait du temps scolaire qu’il requalifie comme saccage du temps (Go, 2019). Écoutons plus précisément ce qu’il nous dit du temps scolaire :
L’école réelle […] sabote l’expérience du temps. L’institution scolaire, dans son fonctionnement concret de tous les jours, incarne une forme de socialisation qui « tue le temps ». L’école n’offre pas aux enfants le loisir de vivre mais elle tourne à vide sur elle-même, sur ses programmes et ses crispations obsessionnelles. Le temps de l’école est rivé à la montre, réduit au tour de cadran des aiguilles, il tourne abstraitement sur lui-même. Les enfants sont pris dans le mécanisme scolastique, ils ne sont plus que l’alibi du temps scolaire […] Or la vraie vie est faite de « choses qui se passent ». Dans la vie, quelque chose arrive, qui nous relie d’un moment à un autre, des événements qui ont fonction de passeurs, de passeurs de temps. La vie nous jette dans des rencontres avec des choses, des perceptions, des situations, des êtres. Nous sommes emportés dans le courant de l’altérité
(Go, 2019, p. 75).
Aussi cette « nostalgie du futur » que Le Clézio (Le Clézio, 2019) aperçoit dans l’inchoativité d’un oxymore n’est-elle pas seulement la déconcertation des jeunes générations devant l’incertitude du monde, mais bien plutôt et au contraire la lassitude d’une enfance privée de son droit à l’imprévisibilité de l’avenir parce que séquestrée dans le temps unique de l’école. Et ce temps programmatique n’est pas sans conséquence sur le savoir lui-même et c’est là encore un nouveau paradoxe de la forme scolaire d’éducation. Car avec la disparition du futur par la forclusion du sens d’être du lieu s’annule la force de l’étonnement qui préside à toute curiosité et tout acte de connaissance. Fabrique d’ignorance où l’école apprend à l’élève à ne plus se poser de questions. Et c’est bien ce qu’il ressort du témoignage troublant de ces jeunes diplômés d’AgroParisTech en 2022 peu fiers d’avoir appris d’une longue formation le droit de tuer le vivant et ses écosystèmes. Il est plus facile de se débarrasser de ce qui contrevient à l’ambition du paysagiste que de comprendre comment s’accommoder de l’indésirable. Qu’est-ce ici sinon le retour de la peur cartésienne qui élimine le monde plutôt que de négocier avec l’état problématique des choses ?
Mais cette forme moderne d’éducation héritée des principes cartésiens n’est pas une fatalité. Il s’agit plutôt d’une forme scolaire en attente de sa reconstruction (Go, 2007, 2014). Et de ce qui précède cette reconstruction ne peut que prendre la forme d’une école qui trouve dans l’inattendu et l’imprévisible l’opportunité de construire auprès des élèves la forme et la force d’une nouvelle puissance d’agir respectueuse du monde et de son intégrité.
Conclusion en forme d’introduction : de la fenêtre du Pioulier ou la défenestration du savoir
Des pratiques correctes à l’institution d’événement
Conclure sur un exemple de reconstruction de la forme moderne d’éducation ne peut en même temps que prendre la forme d’une introduction, c’est-à-dire d’une forme scolaire qui nous réintroduit dans la concrétude du réel. Il faut bien un vice de forme pour se soustraire au diapason cartésien de la certitude. Cet exemple est emprunté à un épisode didactique ayant eu lieu à l’École Freinet construite par Élise et Célestin Freinet dans les années 1930 sur la petite colline du Pioulier. Nous emblématiserons cet épisode comme un paradigme de reterrestration des institutions didactiques et le ressaisirons comme une ascension de l’abstrait au concret (Collectif Didactique pour Enseigner, 2019), c’est-à-dire comme un mouvement qui fait redescendre l’école du Mont Horeb vers la colline du Pioulier. La description de cet épisode didactique donnera lieu à un dialogue entre la mésologie berquienne et la Théorie de l’action conjointe didactique (TACD).
Figure 1. Freinet durant le chantier de construction de l’école
Cet épisode est d’abord l’histoire d’un moment vécu par les élèves de la classe des Grands (CE2-CM2) dont la responsabilité des enseignements me fut confiée entre septembre 2012 et septembre 2018. Aussi devrai-je tout naturellement passer dans un registre d’écriture en première personne. La classe recevait ce jour d’avril 2016 la visite de Carmen Montès, enseignante à l’école de 1975 à 2009, de qui je continuais de recevoir ma formation par la transmission des pratiques correctes de l’École Freinet (Go & Kolly, 2020) qui constituent les pratiques stabilisées d’un patrimoine pédagogique. Encore faut-il préciser ici ce que signifie parler de pratiques stabilisées. S’agit-il de techniques pédagogiques figées dans l’histoire nécessitant d’être simplement reproduites au titre d’une exigence historique et d’un héritage à conserver ? En fait il n’en est rien et écoutons, pour amorcer la réflexion, ces quelques mots de Freinet publiés dans L’Éducateur prolétarien d’octobre 1928 :
Ce grand mot de méthode a été tellement galvaudé par tous les faiseurs de manuels de toutes sortes, qu’il nous est difficile aujourd’hui de lui redonner le sens précis et complet que nous lui voudrions en éducation.
Qui dit méthode, dit système d’éducation basé sur des éléments sûrs, prouvés scientifiquement et coordonnés d’une façon absolument logique.
[…] Organisation matérielle et social de l’école, rythme de travail scolaire, modalité de l’épanouissement de l’enfant, rôle de l’éducateur… Nous ne parlerons nullement de méthodes en cela, mais seulement de techniques éducatives.
Nous voulons par cette appellation nouvelle, montrer d’abord que les diverses solutions que nous apporterons à ce problème ne sont rien par elles-mêmes sans l’esprit de la méthode qu’elles doivent servir ; et aussi, que ces procédés, si nouveaux et si bien étudiés soient-ils, sont eux, à notre mesure, c’est-à-dire, incomplets, sujets à changements fréquents, à perfectionnements incessants pour une marche assurée vers un idéal éducatif
(C. Freinet, 1928, cité par É. Freinet, 1966, p. 15).
Bien entendu il convient de resituer ces lignes dans la juste période d’une pédagogie encore en gestation. Néanmoins elles reflètent déjà ce qui est, dès le début des années 1920 dans l’expérience du Bar où Freinet en est encore à ses débuts jusqu’à la forme actuelle de l’héritage encore transmis à l’École Freinet, à Vence, l’invariant des invariants de l’œuvre freinetienne : la préséance d’un esprit de la méthode sur l’exécution de techniques systématiques et stabilisées. Aussi stabilisées soient-elles, le particulier (Go, 2007 ; Sensevy, 2011) et la pratique correcte de ces techniques tiennent justement dans ce que celles-ci restent habitées par l’esprit d’une culture scolaire ouverte sur la vie qui se laisse déstabiliser par le réel. La stabilité des institutions didactiques de l’école vient de ce qu’elles instituent un jeu polychronique et polyrythmique du temps où l’instabilité de l’événement trouve sa place dans la régularité des rituels pédagogiques. Ces institutions didactiques sont donc d’abord établies sur le fondement générateur d’une institution de l’événement. Et l’esprit freinetien de la méthode naturelle est l’expression exactement antonymique de la méthode cartésienne et de son désir de certitude.
Mais comment instituer l’événement qui par définition demeure l’imprévisible surgissement de l’inattendu ? D’abord par l’institution d’une bonne humeur (Go, 2007 ; Sensevy, 2011, p. 616-620) dont la tonalité affective fonde tout le déploiement du jeu épistémique entre professeurs et élèves. Cette atmosphère, dont les professeurs autant que les élèves acceptent de jouer le jeu, configure un nouveau réel didactique, plastique et flexible, ouvert à l’intrusion possible d’un élément désorganisateur dès lors que celui-ci manifeste un potentiel didactique. Le professeur, tout particulièrement, incarne dans cette légèreté instituée du jeu professoral cette forme de sérénité (Gelassenheit), thématisée par Heidegger, qui fait la « confiance » et l’« appropriété » (Heidegger, 1959, p. 165) d’une posture topogénétique (Sensevy, 2011 ; Collectif Didactique pour Enseigner, 2019) toujours accordée aux situations même les plus incongrues. Nous ressaisissons donc bien la pratique correcte de l’école, non pas comme une pratique stabilisée, mais plutôt comme une action dynamique et stabilisatrice fondée sur une manière adéquate d’agir en situation, en fonction des réponses du milieu. La bonne humeur freinetienne est donc profondément capacitaire puisqu’elle libère chez le professeur une puissance d’agir qui est d’abord une puissance d’accueillir. La peur du réel didactique cartésien y est donc inversée en hospitalité tranquille devant l’étrangeté possible des situations.
Mais cette ambiance thymique de la classe institue surtout le jeu de la curiosité, cette libido sciendi qui s’origine dans un désir d’étonnement et de surprise (θαυμάζειν). Le jeu épistémique entre professeurs et élèves peut devenir une manière de jouer avec la surprise en apprenant depuis ce que la surprise laisse apparaître. Mais qu’est-ce que la surprise ? La surprise peut déjà se définir comme l’intonation affective provoquée par l’apparition d’une chose à laquelle on ne s’attendait pas. Elle surgit donc en dehors de toute prévision mais surtout à la condition de son imprévisibilité même et contre toute attente puisque « c’est parce que nous ne savons pas, que la surprise nous affecte »14 (Marion, 2016, p. 19). Cette rupture de tout horizon présomptif provoque comme sa nécessaire conséquence une mutation du sujet qu’elle rend à sa passivité. La surprise advient comme l’apparition de quelque chose qui est subi (ibid., p.18). Mais alors comment instituer ce qui ne peut que prendre la forme d’une totale soumission à la vie parfois imprévisible des phénomènes ? En instituant le droit à la déprise qui est la possibilité de se déprendre du cours des choses en laissant le cours des choses ouvrir de possibles bifurcations. Mais le possible fait encore partie du jeu volontaire de l’anticipation puisque celui-ci consiste très précisément dans cette attitude active depuis laquelle je me représente la possibilité de l’à-venir comme de ce qui peut venir à l’effectivité. Instituer l’événement ne peut donc pas être autre chose que se déprendre du cours des choses en acceptant d’accueillir jusqu’à l’impossibilité qui est le sens d’être même de la surprise. Maldiney a su ressaisir avec une acuité sans pareille ce paradoxe de l’événement qui contredit toute logique du rapport entre le possible et l’impossible :
L’événement est un existential qui n’est pas sous la dépendance du projet, non plus que l’existence ouverte à l’événement. L’événement par excellence c’est la rencontre, tout particulièrement la rencontre de l’autre […] Au regard de l’autre je suis dans une situation de passivité et d’accueil comme à l’égard de tout événement. Cette situation de passivité ouverte, mais ouverte au Rien, peut s’exprimer ainsi : je suis passible de tout ce qui peut m’arriver, unique et irrépétable, et qui ne répond à aucun système a priori, ni de prévision, ni d’attente. Une rencontre a lieu, si elle est vraiment rencontre, par-delà tout possible. Elle transcende tout attendu […] Le réel, une fois de plus, est ce qu’on n’attend pas. La rencontre ouvre l’attente au moment même qu’elle la comble […] Je ne puis l’accueillir sous aucun horizon dont je sois passible. L’horizon de la rencontre est transpassible. Il est le côté tourné vers nous du hors- d’atteinte, duquel seulement surgit le réel
(Maldiney, 2001, 2014, p. 248-249).
C’est pourquoi nous proposons de requalifier les institutions didactiques de l’École Freinet d’institutions de transpassibilité didactique comme cette aptitude du jeu professoral à s’ouvrir au rien de l’impossible pour en faire le foyer d’une nouvelle possibilité épistémique. Ce jeu professoral capable d’inverser son jeu volontaire en jeu involontaire et passif fait la trajectivité de ces institutions qui didactisent l’événement autant qu’elles se laissent événementialiser par ce dernier.
Revenons-en à présent à cette matinée d’avril 2016 et à son épisode didactique que nous avons jusqu’ici resitué dans le milieu de ses institutions. Je propose de décrire succinctement l’épisode dans un langage narratif ordinaire avant d’en proposer une redescription didactique et mésologique. Il n’existe pas de capture filmique ni d’enregistrement sonore de ce moment didactique étant donné le retard naturellement pris sur un événement qui prend au dépourvu. Je partage donc quelques photographies ainsi que les notes prises dans mon cahier de tâtonnements durant l’après-midi qui suivit.
Je me trouvais en présence de Carmen Montès qui m’accompagnait dans la gestion du plan de travail individualisé des élèves. Les enfants s’affairaient donc à cette routine, qu’ils maîtrisaient depuis son institution dès la classe des Moyens voire parfois des Petits, quand Carmen aperçut derrière la fenêtre de la petite bibliothèque attenante à la classe des Grands une pie. Précisons, et le détail a ici toute son importance, que la fenêtre, donnant directement sur la classe, était ouverte.
Figure 2. La fenêtre ouverte de la classe des Grands est visible à gauche de la photo
Carmen et moi fumes d’abord surpris de sa présence et nous l’étions d’autant plus qu’une pie, qui devait certainement être la même, nous avait déjà rendu visite la veille sur le temps méridien alors que nous mangions à la cantine avec les enfants. Le plus étonnant était qu’elle semblait nous observer avec cette forme de pensivité, si bien décrite par Jean-Christophe Bailly (Bailly, 2018, p. 29), qui prend comme l’allure d’un échange de regards. Quoi de plus déconcertant que de se dire : une pie nous épie, c’est-à-dire, au sens le plus littéral, nous observe depuis l’extérieur. Mais la pie prit son envol pour s’approcher de la fenêtre ouverte qui donnait sur la classe. Je pris le temps de regarder Carmen attendant d’elle quelque chose comme une décision. Fallait-il prendre le risque de la laisser entrer dans la classe alors que les élèves se consacraient tout entier à la discipline du travail ? Carmen avait un grand sourire et cette question ne faisait pas partie de ses préoccupations. Bien au contraire elle dit aux élèves de lever la tête pour vite regarder la pie qui venait de se poser sur le linteau de la fenêtre. Tantôt elle souriait avec sérénité, tantôt elle s’exclamait d’émerveillement avec les élèves quand la pie prit cette fois-ci son envol vers la classe, se posa sur le rétroprojecteur avant de trouver un nouvel appui sur le néon éclairant du tableau. Puis après quelques secondes, elle sortit en « sauts de cloche » caractéristiques en s’agrippant d’abord à la première tignasse qu’elle trouva puis sur une épaule avant de se poser, juste devant la fenêtre, sur le banc carrelé dédié à l’atelier de poterie. Cette sortie déclencha un rire généralisé. Alors Carmen invita les enfants à sortir de la classe pour faire durer le plaisir de cette rencontre. Elle dit aux enfants de lui apporter un peu d’eau et quelques miettes des biscuits qui traînaient dans le coin café de l’école. Puis la pie finit par prendre congé.
Figure 3. La pie devant la fenêtre de la classe posée sur l’atelier de poterie
Carmen fit alors rapidement rentrer les élèves pour qu’ils entament sans attendre un travail d’enquête sur notre visiteuse insolite. Je propose de transcrire sous la forme d’un tableau illustré les propositions didactiques faites par Carmen aux élèves :
Tableau 1. L’atelier de mesurage
| Action du professeur | Action de l’élève |
| Moi je suis sûre qu’elle était jeune cette pie, c’était une jeune pie, elle avait une toute petite queue Tu dirais qu’elle était grande comment cette pie, montre-moi entre tes mains | L’élève symbolise la taille de l’oiseau d’un écart entre ses mains |
| Oui et tu dirais que ça fait combien à peu près | L’élève traduit en centimètres la valeur de l’écart entre ses mains |
| Vérifie sur le mètre de la classe | L’enfant reporte l’écart entre ses mains sur le mètre de la classe pour vérifier son estimation |
Figure 4. L’atelier de mesurage
Tableau 2. L’atelier de pesée
| Action du professeur | Action de l’élève |
| Vous avez vu ce n’est pas lourd une pie même adulte, on a vu qu’elle pesait entre 190 et 200 grammes, c’est lourd comment | Les élèves de l’atelier proposent d’utiliser la balance de type Roberval et de comparer avec des objets de la classe. Ils placent dans le premier plateau les masses équivalentes au poids de la pie adulte et dans le deuxième plateau des objets familiers de la classe, comme des cahiers, des poignées de craie et la brosse du tableau, jusqu’à équilibrage de la balance |
| Vous avez vu, la femelle pond des œufs de 10 grammes, c’est lourd comment | Une élève propose de comparer le poids d’un œuf de pie avec un œuf de poule du poulailler de l’école. Elle va au poulailler et ramène un œuf pondu dans la matinée. Elle pèse l’œuf sur la balance de type Roberval et compare son poids avec la valeur de celui d’un œuf de pie trouvée sur le moteur de recherche. L’œuf de poule pèse 30 grammes. |
| Alors il est plus lourd ou plus léger qu’un œuf de pie, de combien | Les enfants calculent la différence par addition de la valeur pondérale de l’œuf de pie. Ils ajoutent « trois fois » la valeur pondérale de l’œuf de pie. |
| On peut calculer la différence autrement | Certains élèves proposent d’enlever la valeur pondérale de l’œuf de pie à celle de l’œuf de poule qui est plus lourd. Ils enlèvent « trois fois » la valeur pondérale de l’œuf de pie. Certains élèves proposent une solution plus rapide en utilisant la multiplication. |
Figure 5. L’atelier de pesée
Figure 6. L’atelier de pesée avec l’œuf de poule
Tableau 3. Atelier de recherche documentaire et atelier musical
| Action du professeur | Action de l’élève |
| Ah oui, elle jacasse. On ne l’a pas entendu quand elle nous a rendu visite. C’est dommage | Les élèves ont découvert que la pie ne chantait pas comme les autres oiseaux, elle pousse des cris pour communiquer. Elle a des cris de détresse en cas de danger, des cris de ralliement pour se réunir et des cris pour séduire en période de reproduction. Ils découvrent que la pie jacasse et vont vérifier la définition du verbe dans le dictionnaire |
| Les enfants pensent à faire une recherche sonore sur l’ordinateur | |
| Les élèves ont entendu le jacassement de la pie sur le moteur de recherche et tentent de le reproduire à partir des instruments de la classe ou en tapant dans les mains |
Figure 7a. L’atelier de recherche documentaire
Figure 7b. L’atelier musical
Je transcris à présent le compte-rendu d’enquête rédigé par les élèves qui se sont désignés pour ce travail. Durant la phase d’écriture, ils ont pris soin de collecter toutes les informations auprès des camarades qui s’étaient chargés de conduire les recherches ainsi que les expériences. Et durant un temps de regroupement, le compte-rendu a fait l’objet d’une relecture coopérative afin de vérifier l’exhaustivité du contenu d’enquête.
Comme nous l’avons vu, le plumage de la pie est noir avec de beaux reflets bleus. Son ventre, ses épaules et une partie de ses ailes sont blancs. À l’âge adulte, la pie mesure en moyenne 40 centimètres du bec jusqu’au bout de la queue. On a même observé des oiseaux adultes qui mesuraient jusqu’à 56 centimètres de longueur. Entre nos mains, nous estimons d’abord cette grandeur puis nous la vérifions avec le mètre de la classe. La pie est un oiseau de grande taille ! Quand elle déploie ses ailes, elle peut avoir une envergure impressionnante de 60 centimètres. Et la queue peut atteindre 25 à 30 centimètres de longueur. Mais attention ! Elle est plus courte chez les petits. Nous en déduisons que notre visiteuse était un jeune oiseau et qu’elle n’avait pas la queue coupée ou abîmée comme nous le pensions au début. Il est plus lourd qu’une poignée de craies ou que la brosse du tableau, mais il est aussi lourd qu’un cahier rempli de beaux textes. Tous les matins, à la lecture de nos textes, nous tenons l’équivalent d’une pie entre nos mains !
La pie mange de tout. Elle se nourrit d’insectes, d’escargots, de lézards, de petits animaux et même de jeunes oiseaux, comme les carnivores. Mais elle apprécie aussi les fruits et les graines comme les herbivores ou les frugivores. On dit qu’elle est omnivore. Nous comprenons maintenant pourquoi elle s’est régalée des miettes de biscuits que nous lui avions données. Pour chercher sa nourriture, la pie a des pattes bien pratiques, 3 griffes vers l’avant et une vers l’arrière. Nous essayons de les mimer avec nos doigts. En plus, la pie est un oiseau sédentaire. Cela signifie qu’elle ne quitte pas son territoire en hiver et qu’elle ne migre pas vers des régions chaudes quand l’hiver arrive, comme le font les oies sauvages ou le pigeon ramier que nous avons un jour observé dans le pin juste à côté de nos classes. Elle passe toute sa vie au même endroit. Il est donc facile de l’apprivoiser. Peut-être que nous la reverrons pour d’autres petits déjeuners. Pourtant, nous apprenons qu’elle ne pèse, à l’âge adulte, qu’entre 190 et 200 grammes. Avec les poids de notre balance, nous soupesons cette grandeur. Ce n’est pas très lourd. Et si nous posions des objets familiers de la classe pour les comparer au poids de notre oiseau ?
Entre avril et mai, le mâle et la femelle s’accouplent et construisent ensemble un nid dans les hautes branches d’un arbre ou caché dans un buisson épineux. Il est fabriqué à partir de ronces et de brindilles emmêlées. À l’intérieur, il est recouvert de mousse et de feuilles mortes. La femelle pond par nichée entre 3 et 10 œufs qui pèsent chacun 10 grammes environ. Nous soupesons cette grandeur avec le poids de la balance. Qu’il est léger ! Et chouette ! Notre poule a pondu un de nos œufs les meilleurs du monde ! Nous allons pouvoir comparer son poids à celui d’un œuf de pie. Sur notre balance, l’œuf de notre poule pèse environ 30 grammes, il est 3 fois plus lourd qu’un œuf de pie. La femelle couve ses œufs pendant 18 jours environ et les parents nourrissent leurs petits pendant 3 à 4 semaines après éclosion. Au bout d’un mois après leur naissance, les petits quittent leur nid. Heureusement que nos parents ne font pas la même chose avec nous !
Nous avons aussi appris quelque chose de très étonnant, les pies ne chantent pas comme les autres oiseaux. Elles communiquent entre elles avec des cris qui ont des sens précis. Elles ont des cris de détresse en cas de danger, des cris de ralliement quand elles ont besoin de se réunir et même des cris amoureux pour se séduire. Elles possèdent donc comme nous un vrai langage. On dit que la pie jacasse ou qu’elle jase. Nous vérifions ce mot dans le dictionnaire et nous découvrons qu’au sens figuré, ce verbe désigne une personne qui bavarde. Vite, nous faisons une recherche internet pour écouter le bavardage de notre pie. On entend un « chack-chack ». Le rythme de son cri est rapide et change régulièrement. Dans nos mains nous essayons de le taper. Pas facile ! Les musiciens de la classe disent qu’elle parle en croches et même en doubles croches. Et puis, nous nous mettons à parler comme des pies… Nous cherchons à décrire le timbre de son langage. Certains trouvent qu’il est plutôt sec, d’autres au contraire plutôt gras. Et si on essayait avec des instruments ? Chouette recherche !
Pour terminer la présentation de ce matériau empirique, je transcris enfin le texte libre qui raconte l’histoire de cette rencontre inattendue avec la pie. Après une phase individuelle d’écriture, le texte fit l’objet d’une relecture ainsi que d’une écriture coopérative durant le toilettage rituel du texte au tableau.
La Chipie
Hier, une pie est venue nous rendre visite à la cantine. Elle avait le bec fin et son plumage était noir et blanc. On avait l’impression qu’elle avait la queue coupée. Au début, elle nous regardait derrière la vitre de la fenêtre puis nous avons décidé de lui ouvrir pour lui donner à manger. C’est là que nous avons découvert qu’elle aimait les courgettes. Aujourd’hui, la coquine est revenue ! Hé. Elle est rentrée dans notre classe, elle est montée sur le tableau et le projecteur. Elle a même fait un saut sur la tête d’Emiliano ! Nous lui avons préparé un petit déjeuner : des biscuits et de l’eau. Qu’elle est gourmande, elle n’est même pas farouche ! Peut-être est-elle apprivoisée ? Nous lui avons trouvé un nom, c’est 3,14 comme le nombre π. Et elle est partie vers d’autres aventures… Lorna et Nathan
Figure 8. Illustration accompagnant le texte libre
Dégageons à présent les enseignements didactiques et mésologiques de ce matériau empirique en ayant toujours à l’esprit le projet de reconstruction de la forme scolaire qui préside au déroulement de cet épisode didactique. Et il convient en même temps de ressaisir la participation de sa charge événementiale comme un aspect essentiel de la reconstruction. Cet épisode didactique ouvre donc la possibilité d’un voir comme (Collectif Didactique pour Enseigner, 2019 ; Wittgenstein, 1953, 2004) sur une manière absolument autre d’incarner le métier de professeur et d’assumer l’exigence d’une pratique de savoir à partir d’un élément adidactique. Nous percevons bien au sein de cet extrait didactique la déflagration produite par l’irruption violente, parce que totalement intrusive, d’un événement qui fait voler en éclats toute prétention à une quelconque unité de lieu, de temps et d’action caractéristique d’une forme scolaire classique. Et le travail d’équilibration didactique, œuvrant à réacheminer l’événement vers une production de savoir, tient tout entier à la posture d’un connaisseur pratique (collectif Didactique pour Enseigner, 2019) qui ne se fige pas dans le didactisme mais au contraire naturalise le jeu épistémique autant que la relation didactique avec les élèves. Emblématiser la valeur reconstructive de cet exemple consiste donc à comprendre comment un événement perturbateur des institutions didactiques s’est inversé en élément organisateur d’un processus d’enquête et d’apprentissage (Clanché, 1988, p. 18). C’est cet aspect-là de l’épisode didactique que nous nous attacherons à valoriser et modéliser.
De la contingence phénoménologique à la nécessité didactique
En termes didactiques le travail de redescription doit permettre de clarifier deux éléments, corrélatifs l’un de l’autre, essentiels à l’intelligibilité de cet épisode pédagogique. D’une part il s’agit de comprendre comment la contingence d’une situation tout à fait exogène à la vie des enseignements, l’intrusion d’une pie dans la classe des Grands, a pu se constituer en milieu didactique. Précisons que dépend de la production d’un milieu didactique la possibilité d’apprendre, si par milieu didactique il convient d’entendre un état problématique du monde (Collectif Didactique pour Enseigner, 2019, p. 21) dont la résolution nécessite la réactivation d’un répertoire de connaissances acquises en même temps que l’élaboration de nouvelles stratégies épistémiques. Le savoir consiste bien dans cette malléabilité des habitudes et dans leur aptitude à ne pas s’indurer en routines (Dewey, 1916, 2018, p. 129) pour accueillir et thésauriser de nouveaux aspects du monde que l’arrière-plan du contrat didactique ne suffit pas à expliciter. En ce sens le milieu didactique doit permettre aux élèves de rencontrer leur ignorance (Mercier, 1999) qui est en même l’impertinence épistémique des savoirs constitués à l’épreuve d’une situation nouvelle. D’autre part il s’agit de ressaisir la nature du milieu didactique qui s’est constitué à partir de l’événement perturbateur en comprenant la problématicité du problème qui va être dévolu au jeu épistémique des élèves.
Cherchons dans notre épisode didactique la possibilité d’un éclaircissement. Ou plutôt essayons d’abord de contrefactualiser cet épisode par une variation imaginative en supposant que le professeur s’y soit pris autrement (Collectif Didactique pour Enseigner, 2019, p. 11). Et cette possibilité ressort de l’épisode lui-même lorsqu’à l’approche de la pie vers la fenêtre des Grands j’attends qu’elle prenne la décision de fermer la fenêtre pour sauvegarder le rituel bien rodé du plan de travail (figure 2). Nous voyons que l’épisode tient tout entier dans la liberté pratique du professeur qui conserve la possibilité de faire un choix. Carmen aurait pu en effet fermer la fenêtre et interrompre le cours de l’événement. Mais nous pensons qu’il n’en est rien puisque la question du choix ne semble même pas s’être posée à Carmen. Il y a dans l’attitude du professeur l’évidence de quelque chose à vivre et d’une expérience d’abord intéressante pour elle-même. Le renversement de cette contingence phénoménologique en nécessité didactique vient de ce que le professeur n’est ici jamais en retard sur l’événement mais toujours contemporain de son déroulement. C’est cette appropriété que nous avons cherché à thématiser avec Maldiney par l’idée d’une transpassibilité didactique qui est ici l’aptitude du professeur à ne rien attendre de la situation pour la rendre à sa phénoménalité gratuite, fraîche et joyeuse. L’événement se potentialise didactiquement de ce que le professeur lui accorde le droit d’exister et la possibilité d’affecter les élèves. D’ailleurs soulignons ce fait qu’elle prend elle-même l’initiative d’intéresser les élèves à l’approche de la pie. Le trait caractéristique de cet épisode vient donc de ce que le professeur s’accorde à la mobilité du réel que nous pouvons ressaisir avec Berque comme la dimension de sa mouvance (Berque, 2010, p. 141-158) dans laquelle nous faisons spontanément l’épreuve de son mouvement et de son changement. En ce sens cet épisode didactique peut être vu selon ce que Thibaut Bouchet-Gimenez a thématisé comme un jeu de l’instant (Bouchet-Gimenez, 2022). Le devenir didactique de l’événement n’est donc pas secondaire à l’événement comme un forçage didactique de la situation mais un moment parfaitement endogène à la perturbation. C’est parce que l’événement trouve ici le lieu passif de son déploiement qu’il peut ouvrir un horizon actif d’apprentissage :
Le sens dans lequel je parle de mouvance allie ces deux emplois. Je veux dire par là d’abord que la relation écouménale est à la fois passive et active. Elle joue dans les deux sens. Comme la chôra platonicienne qui est à la fois matrice et empreinte, notre milieu est à notre égard dans un état de mouvance passive et active : il est le domaine sur lequel nous agissons, et qui porte les marques de cette action, mais il est aussi le domaine qui nous affecte et auquel nous appartenons de quelque manière
(Berque, 2019, p. 142).
Mésogénèse, topogénèse et chronogénèse : du monde de l’école au monde de la pie
La constitution mésogénétique du milieu didactique, c’est-à-dire la conversion de l’événement en élément didactique, repose donc sur un traitement particulier de la topogénèse et de la chronogénèse qui laisse à cet événement un lieu pour exister et le temps d’exister. Ce déploiement écouménal de l’événement réside d’abord dans la position topogénétiquement basse (Sensevy, 2011 ; Collectif Didactique pour Enseigner, 2019, p. 31) adoptée par le professeur qui joue de sa posture professorale sur le mode de la réticence (Sensevy, 2011 ; Collectif Didactique pour Enseigner, p. 26) pour laisser apparaître l’urgence d’une réalité ne pouvant être remise à plus tard. Cette réticence n’est donc pas ici un usage particulier du langage et de la parole professorale mais plutôt une sémiose corporelle dans un jeu avec la présence. Sur le mode d’une présence-absence Carmen discrétise sa position dans la classe et son système d’attente didactique pour décentrer l’attention des élèves vers l’expression d’un monde sensible. Sa topogénèse n’est plus temporairement didactique mais cosmophanique, elle se montre en train de regarder un épisode du monde que les élèves commencent d’abord par regarder avec elle en dehors de toute préoccupation didactique. Aussi temporalise-t-elle la vie de la classe, par l’effet d’un ralentissement chronogénétique du temps didactique, sur le rythme de cette perturbation en faisant vivre le groupe d’élèves à l’échelle de son événementialité. Carmen « passe le temps qu’il faut à ce qu’il faut » (Collectif Didactique pour enseigner, p. 302) et prend avec les élèves le temps de vivre cette intrusion magique de l’oiseau dans la classe.
Il faut souligner combien la fenêtre du Pioulier diffère ici de la fenêtre cartésienne. Son lieu apparaît comme un non-lieu hétérotopique (Foucault, 1967, 1984) qui brouille le partage classique du dedans et du dehors, « un lieu d’un genre particulier, qui bien qu’étant entre eux, n’est aucun de ces deux-là, donc un lieu sans lieu, des plus équivoque et hautement vibratile » (Loreau, 1971, p. 491). La contingence sensible s’infiltre dans le templum sanctuarisé de la classe, ce « lieu retranché, coupé du monde et replié sur soi – ferme poste d’observation soustrait à l’instabilité des dehors infinis » (ibid., p. 494) et invite professeur comme élèves à s’exfiltrer de leur position institutionnelle pour suivre le cours sensible et concret des choses comme de simples étants terrestres (figure 3). Carmen laisse se déployer une défenestration des institutions didactiques15. Les élèves cessent d’être les contemplateurs scolaires et distanciés du monde pour lequel l’école les prépare, c’est le monde qui les prépare à sa propre représentation. Professeur et élèves quittent le lieu cursif de la forme scolaire classique et « l’univers plus que sommaire qui leur servait de scène commune » où le monde se trouvait jusqu’alors « partagé, de manière insistante, entre calmes voyeurs d’une part, campés à leurs fenêtres, bouillants acteurs, de l’autre » (ibid., p. 487). Et c’est en cet endroit que se précise la réponse au deuxième aspect de la question que nous posions au départ de cette réflexion. Quel problème, en lequel se constitue la didacticité du milieu, les élèves vont-ils avoir à résoudre ? La réponse est simple : il s’agit du monde de la pie.
Jeu épistémique, jeu d’échelle et institutions symboliques
L’épisode didactique montre avec une clarté transparente un trait essentiel de la reconstruction scolaire. Le professeur et les élèves ne s’enferment pas dans le circuit abstrait des représentations qui n’est rien d’autre que l’assujettissement cartésien du monde au jeu de la proportion mathématique et géométrique. C’est pourquoi nous dirons, avec Berque, que le jeu épistémique devient ici un jeu d’échelle qui accordera le travail ultérieur des représentations construites avec les élèves à l’échelle de ce qui aura été vécu. La reconstruction de la forme scolaire passe donc par un glissement de la proportion à l’échelle.
Ainsi, à la différence de la proportion, l’échelle ne peut s’affranchir des grandeurs du monde sensible qui impliquent l’existence humaine. En cartographie, l’échelle est d’ailleurs justement ce qui rapporte la représentation graphique au territoire de grandeur réelle où se meut notre corps
(Berque, 2010, p. 98).
La classe se laisse d’abord déprendre de ses habitudes scolaires, celle du plan de travail en l’occurrence, pour avoir de nouvelles prises sur l’inchoativité d’un événement qui est en attente d’intelligibilité. Il y a là, dans le surgissement de cette pie et dans son comportement presque familier avec les élèves et le monde des hommes, quelque chose à comprendre. Et la dialectique contrat-milieu (Sensevy, 2011, Didactique pour enseigner, 2019, p. 25), qui fonde la possibilité d’apprendre en redynamisant le déjà-là des élèves vers l’acquisition de nouvelles connaissances, prend déjà la forme d’une dialectique entre échelle et proportion. Échelle du vécu et du milieu-soi (Collectif Didactique pour Enseigner, 2019, p. 595) par introjection du monde (tableaux 1 et 2, figures 4, 5 et 7b) dans le corps médial et proportion des représentations scolaires par projection des savoirs (tableaux 2 et 3, figures 3, 7a et 8) vers un milieu qui gagne en intelligibilité (Berque, 2010, p. 208). L’atelier de mesurage (tableau 1 et figure 4) et de pesée (tableau 2, figures 5 et 6) montre bien comment l’incommensurabilité affective de l’expérience sensible est d’abord ressaisie par un écart entre les mains ou par des objets familiers sous-pesés à la main (des cahiers, la brosse du tableau, une poignée de craie, un œuf de poule) avant d’entrer dans le circuit institutionnalisé de la grandeur mathématique afin de « tuer » la représentation « en tant que fétiche » (Clanché, 1988, p. 34-35)
Il faut, pour conclure, souligner un aspect fondamental de toute la réflexion qui a été conduite jusqu’ici et il s’agit en même temps de dissiper un possible malentendu. L’incertitude ne doit pas être cultivée pour elle-même, habiter nécessite un système d’habitudes stables qui seules permettent de s’orienter avec fiabilité dans le monde. Rappelons à cet égard que le terme même « habiter » provient du verbe latin habitare reflétant la nécessité d’une accoutumance et d’une habitude.
Finalement, donc, qu’est-ce que rencontrer l’ignorance ? C’est se trouver dans une incertitude épistémique. Je sais, j’ai compris que je ne sais pas. À cette incertitude épistémique peut être rattachée de l’incertitude affective : je sais que je ne sais pas, j’aimerais savoir, et cette distance entre mon état actuel et ce que je poursuis peut être source d’inconfort […] Mais c’est un inconfort qui n’est pas « existentiel », sa cause n’est pas occulte ou lointaine, on pourrait dire, avec un peu d’emphase, qu’il s’agit de l’inconfort dû à la libido sciendi qui ne trouve pas à s’accomplir. C’est ce type d’émotion cognitive qui donne l’une de ses capacités à l’activité intellectuelle, qualité qui pourra amener l’élève, celui qui étudie, à trouver dans le doute issu de la rencontre de l’ignorance […] un moteur de l’activité. À cette incertitude épistémique correspond la certitude épistémique, celle que j’ai nommée […] certitude raisonnée
(Sensevy, 2011, p. 495).
Mais la mobilité essentielle du monde oblige ces habitudes à se remettre en jeu dans le jeu écouménal de la médiance et de la trajectivité. Habiter implique donc aussi ce jeu de la déshabituation. Et ces temps de crise viennent de ce que l’homme moderne et cartésien n’a pas su négocier avec l’instabilité des choses qu’il s’est contenté de fermer au dehors. Il a chassé par la porte un monde qui jamais ne cessera de revenir par la fenêtre !